Conférence
La lutte contre le réchauffement climatique va se jouer sur les rives du Pacifique
Jean-Christian CADY Préfet honoraire
Les conférences sur le climat n’ont pas la réputation d’être efficaces.
Elles se réunissent chaque année depuis 1995 dans le cadre de l’ONU. Elles rassemblent tous les pays du monde et ont pour objet de définir un accord contraignant, mais librement consenti par les parties, visant à limiter l’émission de gaz à effet de serre. Mais depuis le protocole de Kyoto établi en 1997, les négociations ont piétiné, les engagements ont été modestes et peu respectés, la volonté des Etats peu affirmée et le consensus inexistant. Certains se sont même interrogés sur l’utilité de ces réunions.
La 21ème conférence sur le climat qui se tiendra à Paris de Paris du 30 novembre au 11 décembre 2015 (COP21), échappera-t-elle au destin des précédentes ? Permettra-t-elle d’enregistrer des progrès dans la volonté des pays de lutter contre le changement climatique et la mise en œuvre de mesures pour y parvenir ? Ira-t-on au delà de l’opération de communication pour entrer dans le concret et le contraignant ?
L’enjeu est essentiel. Le but est d’éviter que les températures globales de l’atmosphère augmentent de plus de deux degrés par rapport au début de l’ère industrielle, c’est-à-dire 1850. Pour cela il faut diminuer l’émission dans l’atmosphère des gaz contenant du carbone, essentiellement le gaz carbonique qui est le principal vecteur de la création de l’effet de serre. Le réchauffement induit par le CO2 se poursuit en effet pendant plusieurs siècles.
Pour limiter le réchauffement à 2 °C, les émissions devront être nulles, voire négatives, à la fin du 21e siècle. Pour l’instant nous en sommes loin. Le rythme moyen d’accroissement annuel de GES qui était de 1,2 % entre 1970 et 2000, est passé à 2,3 % entre 2000 et 2010.
C’est donc une transformation globale des modes de production et des comportements individuels qui est demandée aux Etats, aux entreprises et aux populations pour permettre un développement compatible avec la préservation de l’environnement de notre planète.
I L’action de la communauté internationale sur le climat est-elle vouée à l’échec ?
Il faut partir de trois constatations.
- La prise de conscience du caractère anthropique du réchauffement climatique a été lente.
- Des mécanismes ont été élaborés pour inciter les pays à lutter contre l’émission de gaz à effet de serre.
- Les résultats ne sont pas pour l’instant à la hauteur des espérance
La prise de conscience du caractère anthropique du réchauffement climatique a été lente.
Pendant longtemps, le désaccord a prévalu chez les scientifiques. Certains niaient l’existence même d’un réchauffement et considéraient que la période d’observation du climat n’avait pas eu une durée suffisante pour en tirer des conclusions. D’autres, tout en admettant l’élévation générale des températures, contestaient que les activités humaines en soient la cause, excipant du fait que la terre a connu au cours des âges géologiques de nombreuses périodes de réchauffement bien avant le développement des activités industrielles, extractives ou agricoles et même bien avant l’apparition de l’homme. En 2009 encore l’Académie des Sciences de Moscou publiait un rapport en ce sens.
Si ces thèses ont connu un écho favorable auprès des entreprises des secteurs pétroliers et charbonniers et auprès de certains milieux conservateurs américains (Tea Party), le consensus sur la réalité du réchauffement et son origine humaine prévaut maintenant.
La question du climat a fait son entrée dans la vie internationale il y a vingt cinq ans. Un rapport d’évaluation du groupement intergouvernemental des experts pour le climat (GIEC) faisait en 1990 la synthèse des informations scientifiques alors disponibles et concluait que les changements climatiques et l’augmentation des températures étaient liés à l’accumulation de gaz à effet de serre (GES).
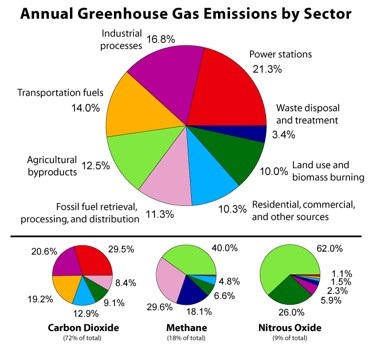
Lors du Sommet de la Terre à Rio en 1992, une convention-cadre des Nations unies sur le changement climatique (CNUCC) prenait acte de l’existence de ce réchauffement et de son origine liée aux activités humaines. Elle reconnaissait aussi la responsabilité première de pays industrialisés et leur imposait de limiter les émissions de GES pour stabiliser les concentrations de carbone dans l’atmosphère.
Le défi est mondial. C’est évidemment la planète tout entière qui est concernée. Le gaz carbonique produit à Pékin ou Djakarta a un effet à Paris ou New York. Mais les Etats riverains du Pacifique ont un rôle particulier à jouer puisque certains d’entre eux figurent parmi les plus grands producteurs de gaz à effet de serre et que d’autres Ŕ mais parfois les mêmes Ŕ sont au nombre des victimes de cette pollution.
Il s’agit donc pour chaque pays de faire un effort pour limiter et même réduire ses émissions de GES, effort qui se traduit par un surcoût. Or pour chaque Etat pris isolément, il n’y a pas de corrélation immédiate entre les efforts qu’il va faire et les avantages directs qu’il va en retirer. De plus l’impact des efforts est éloigné dans le temps. Ce n’est pas à court terme que l’on voit les résultats d’une diminution des gaz à effet de serre. Et lorsque les résultats se voient, toute la planète en bénéficie et pas seulement l’Etat qui a fait des efforts. Autrement dit, la tentation pour de nombreux pays est de ne rien faire et d’attendre que ses voisins prennent l’initiative. La position idéale Ŕ d’un point de vue égoïste Ŕ est celle du passager clandestin, celui qui prend le bateau sans payer le voyage. Et il est vrai que les négociations sur le climat ont longtemps achoppé sur le fait qu’aucun Etat n’avait intérêt à s’engager unilatéralement sans être certain que d’autres pays s’associent dans le cadre d’une coalition plus large.
Des mécanismes ont été élaborés pour inciter les pays à lutter contre l’émission de gaz à effet de serre.
La CNUCC de Rio a introduit un mode de gouvernance de la question climatique en prévoyant que chaque année, les pays parties se réunissent en fin d’année dans le cadre de la Conférence des parties (COP) où sont prises les décisions importantes. Les 195 pays et l’Union européenne.qui ont ratifié la convention, vont participer à la conférence sur le climat de Paris de décembre prochain.
A la suite de l’accord de Rio en 1992, le Protocole de Kyoto a été signé en 1997. Il vise à réduire l’émission globale de six gaz à effet de serre qui sont le résultat de l’activité humaine : le méthane, le gaz carbonique, le protoxyde d’azote, le perfluocarbure, l’hydrofluorocarbure et l’hexafluorocarbure. Il est entré en vigueur en 2005 lorsque 55 % des Etats représentant au moins 55 % des émissions de carbone l’ont ratifié.
Le protocole de Kyoto reprend et décline les trois principes élaborés à la conférence de Rio, à savoir:
- Le principe de précaution indiquant qu’en dépit de certaines incertitudes scientifiques quant aux impacts du changement climatique, il convient d’agir immédiatement
- Le principe de responsabilité commune mais différenciée qui précise que les pays les plus industrialisés portent une responsabilité accrue de la concentration actuelle des gaz à effet de serre dans l’atmosphère.
- Le principe du droit au développement économique des pays peu industrialisés.
En outre, le Protocole de Kyoto introduit deux éléments :
- D’une part un engagement pris par 37 pays développés et en transition de réduire leurs émissions de carbone. Les Etats prennent librement ces engagements qu’ils sont tenus de respecter.
- D’autre part la mise en place d’un système fixant des quotas d’émission de carbone et permettant à ces pays d’échanger des droits d’émission de GES pour faire émerger un prix international du carbone. Les rejets dans l’atmosphère, jusque-là gratuits, ont désormais un prix.
En vue de faciliter la réalisation des engagements des pays industrialisés, trois mécanismes de flexibilité ont été créés :
- Un marché international de quotas ca Chaque pays reçoit autant d’Unités de Quantité Attribuée (UQA) que son objectif d’émissions de GES fixé par le Protocole. Les UQA sont échangeables entre Etats ;
- Le Mécanisme pour un Développement Propre (MDP) et
- Le Mécanisme de Mise en Œuvre Conjointe (MOC) permettent de financer des réductions d’émissions hors du territoire national contre l’octroi de crédits carbone échangeable
Le MDP est un projet de réduction d’émissions ayant lieu dans un pays qui n’a pas d’engagement au titre du Protocole de Kyoto, la MOC dans un pays qui en a souscrit au Protocole de Kyoto.
Gérés par la CCNUCC, ces mécanismes donnent lieu à la délivrance de crédits de compensation (un crédit pour une tonne de CO2 ou d’équivalent CO2) à hauteur des émissions évitées grâce à la mise en œuvre du projet concerné.
L’idée est simple : il s’agit de faire de carbone un produit monétisé et échangeable. Chaque pays fixe des quotas à ses entreprises. Si une entreprise émet plus que son quota, elle peut acheter des crédits carbone à une autre entreprise qui en émet moins. L’entreprise qui achète des crédits carbone augmente ainsi son quota d’émission et a donc acheté des droits à polluer. C’est donc un système pollueur-payeur qui a été créé. Et un marché du carbone s’est instauré où s’échangent des crédits carbone, les permis d’émission devenant des produits financiers. L’objectif de ces crédits carbone est évidemment d’encourager des systèmes de production plus propres en pénalisant les plus polluants.
Une autre possibilité pour l’entreprise qui a des crédits carbone parce qu’elle est en-dessous du quota d’émission, est de vendre ces crédits à des fonds propres chargés de favoriser et de financer des projets de réduction d’émission dans les pays en voie de développement. De nombreux projets ont été financés de cette manière depuis des plantations de forêts, puisque les arbres stockent le carbone de l’atmosphère jusqu’à des microprojets industriels.
Relativement simple dans son principe, la gestion des crédits carbone se heurte à des obstacles dans la vie réelle. Il n’y a pas de prix international du carbone mais seulement des prix locaux. Des prix locaux existent déjà dans les trois grandes zones qui émettent le plus de GES, en Europe, aux Etats- Unis (sur la côte est et en Californie) et en Chine (sept marchés locaux destinés à se fondre dans un marché national en 2016). Or, ces trois pays représentent 50 % des émissions mondiales. Un lien entre ces marchés pourrait conduire à la formation d’un prix international. En somme, une coalition des grands émetteurs pourrait permettre ainsi de faire un grand pas assez rapidement.
Dans la pratique, cela risque d’être un peu plus compliqué. L’établissement de liens entre ces marchés peut demander du temps en raison de la différence des prix pratiqués.
D’autres initiatives pour réduire la trace carbone sont prises mais se heurtent souvent à l’opposition de groupes de pression. La France en fournit l’illustration. Le principe de taxer les émissions de carbone par les poids lourds sur les routes et les autoroutes avait été voté par l’Assemblée Nationale avec une forte majorité, comme la plupart des mesures définies au « Grenelle de l’Environnement ». Lorsqu’il a fallu mettre en œuvre ces principes, le lobby des transporteurs routiers s’y est violemment opposé, parlant de distorsion de la concurrence et les équipements qui avaient été installés à grands frais, ont dû être démontés (à grands frais également).
Cet épisode français montre que l’un des obstacles principaux à la mise en œuvre de mesures limitant la production de gaz à effet de serre est la crainte d’un pays ou d’une profession d’être pénalisé dans ses coûts de production et donc dans sa compétitivité par rapport à ses voisins. La lutte contre le réchauffement climatique est une affaire mondiale, mais la plupart des pays gardent une approche purement nationale, voire sectorielle.
Les résultats ne sont pas pour l’instant à la hauteur des espérance
En effet la question du financement n’est pas résolue et les émissions de gaz à effet de serre ont continué à progresser.
La question du financement n’est pas résolue.

Emissions de gaz à effet de serre
Il existe un désaccord profond entre les pays industrialisés et ceux en voie de développement. Ces derniers font valoir que depuis le début du XIXe siècle, les pays développés ont construit leur industrie et leur agriculture sans se préoccuper des conséquences pour l’environnement. Ce n’est que depuis quelques décennies, alors qu’ils ont atteint un niveau élevé de développement, qu’ils se soucient de l’impact sur l’environnement. Imposer les mêmes contraintes aux pays en voie de développement (PVD) qu’aux pays développés ralentirait l’industrialisation des PVD et aurait pour conséquence de les condamner à la stagnation. Cet argument ne manque pas de poids et est mis en avant notamment par l’Inde, l’Indonésie et des pays d’Amérique latine. La Chine se fait leur porte- parole. Les pays en voie de développement veulent bien prendre des engagements, mais pour plus tard. Dans l’immédiat, ils ne changeront pas grand chose dans leurs modes de production. Et s’il faut absolument changer, ils demandent qu’on les aide.
C’est d’ailleurs ce que la conférence de Copenhague en 2009 avait prévu. A la dernière minute et dans le chaos et les récriminations qui ont marqué la fin de cette conférence qui a été un échec, 100 milliards de dollars ont été promis aux pays en voie de développement pour les aider à s’adapter. Cette promesse est toujours d’actualité.
On peut se poser une question qui fâche : pourquoi 100 milliards de dollars ? A quoi correspond ce chiffre ? Comment a-t-il été calculé ? Sur quelles études repose-t-il ? La réponse est que c’est un chiffre rond qui frappe les esprits et qui a été lâché sans étude préalable. Pour quels projets ? Il y a des intérêts radicalement divergents entre les pays du Nord et du Sud. Les premiers ont en effet plutôt intérêt à ce que l’argent aille aux projets d’atténuation, c’est-à-dire à tout ce qui permettra de limiter les émissions pour limiter le réchauffement (énergies renouvelables, transports publics, etc.) quand les seconds ont besoin de financer des projets d’adaptation, à savoir tout ce qui leur permettra de faire face aux conséquences du réchauffement (digues, irrigation, etc.). Or, aujourd’hui, la quasi- intégralité de l’argent va vers l’atténuation.
On peut alors se poser la deuxième question qui fâche : comment ces 100 milliards de dollars vont- ils être financés ? Qui va payer et comment ? Les réponses restent floues en cette période de crise.
Les financements doivent venir des budgets des Etats mais aussi des institutions internationales, des banques de développement et du secteur privé. Qui va payer et comment ? En 2014, l’aide aux pays les plus vulnérables pour le financement climatique a été de 61,8 milliard $, dont 43 milliards sont issus de sources publiques (financements bilatéraux et multilatéraux, banques de développement et organisations spécialisées de l’ONU), 1,6 milliard $ venant de crédit export et le reste venant de fonds privés. Donc le compte n’y est toujours pas mais on progresse : les 61,8 milliards$ de 2014 sont une hausse par rapport aux 55,2 milliards de 2013.
Pour l’instant le financement des 100 milliards de dollars pour la lutte contre le réchauffement climatique n’est pas assuré. De plus il faut s’assurer que cet effort des pays développés en faveur du climat ne vienne pas siphonner les fonds consacrés à l’aide au développement qui ont été de 134 milliards de dollars en 2014.
La question est d’autant plus grave qu’à partir de 2020, ce sont 100 milliards de dollars chaque année qui doivent être financés. Certains ont beau jeu de dire que si l’on compare 100 milliards de dollars aux dégâts que font les cyclones, ce n’est pas hors de proportion. Ainsi les pertes économiques dues au cyclone Katrina qui a fait 1200 morts à la Nouvelle Orléans en 2005 ont été de 125 milliards de dollars. Et le cyclone Sandy de 2012 a fait 70 milliards de dollars de dégâts dans les seuls états de New York et du New Jersey. Il n’en demeure pas moins que le financement de ces 100 milliards de dollars sera un marqueur du succès ou de l’échec de la Conférence de Paris.
Les émissions de GES ont continué à progresser en particulier dans les pays riverains du Pacifique.
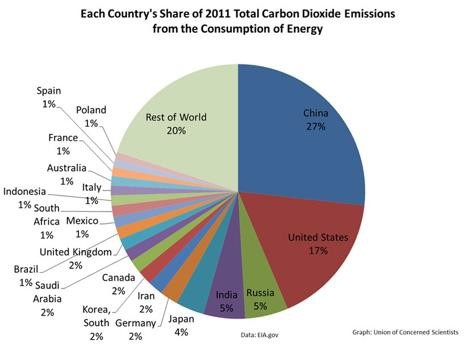
La Chine et les Etats-Unis sont les premiers émetteurs de dioxyde de carbone. La Chine est le premier producteur et le premier consommateur mondial de charbon. Elle est, de ce fait, le premier émetteur de CO2 avec 9761 millions de tonnes et représente 27,5 % des émissions mondiales en 2014. Les Etats-Unis émettent 5 995 millions de tonnes et comptent pour 16,9 % des émissions mondiales. Si l’on agrège la demande en charbon de 34 pays développés, la Chine constitue 50 % de cette demande globale.
Sans atteindre ces chiffres, d’autres pays riverains du Pacifique sont aussi de forts émetteurs de CO2, la Russie avec 1657 milliards de tonnes (4,7 % des émissions mondiales), le Japon avec 1343 milliards (3,8%), la Corée du sud avec 768 milliards ce qui est un chiffre comparable à celui de l’Allemagne (2,2%), le Canada avec 621 milliards (1,7%), l’Indonésie avec 549 milliards (1,5%).
Les émissions de GES n’ont pas cessé d’augmenter ces dernières années. Les engagements pris par 37 pays industrialisés dans le Protocole de Kyoto d’atteindre une réduction globale des émissions de 5,2 % entre 2008 et 2012, par rapport aux niveaux de 1990, n’ont pas été tenus.
Toutefois une lueur d’espoir se profile. L’agence internationale de l’énergie, institution créée par les pays de l’OCDE à la suite du choc pétrolier de 1974, a annoncé le 13 mars 2015 que les émissions mondiales de dioxyde de carbone sont estimées à 32,3 milliards de tonnes et sont restées stables par rapport à l’année précédente. C’est la première fois depuis quarante ans que cette stabilisation n’est pas liée à une crise. Les trois épisodes précédents de stagnation du CO2 étaient liés à des crises de l’économie mondiale : la récession américaine du début des années 1980, l’effondrement du bloc de l’Est en 1991-1992, la crise financière de 2008.
Cette stabilisation est pour partie à mettre au crédit de la Chine qui veut réduire la croissance de sa part charbon. La Chine a annoncé son intention de réduire ses émissions de GES par unité de PIB de 40 % d’ici à 2020, par rapport au chiffre qui serait atteint si rien n’était fait. Elle veut atteindre son pic d’émission en 2030.
La stabilisation a également bénéficié des efforts des Etats-Unis dans le domaine de la transition énergétique. Ils ont déclaré que d’ici à 2025, ils diminueront leurs émissions carbone de 26 % à 28 % par rapport à 2005.
L’accord intervenu en novembre 2014 entre les Etats-Unis et la Chine sur une réduction de leurs émissions est important et montre que les plus gros émetteurs de gaz à effet de serre sont conscients de la gravité de la situation et sont disposés à agir. Les milieux économiques, qu’il s’agisse des industriels et même des financiers, se déclarent prêts à coopérer.
Pendant les premières années de la mise en œuvre du Protocole de Kyoto, des gouvernements, n’ayant pas confiance dans les mécanismes de l’ONU et inquiets du coût de la taxe carbone, n’ont pas voulu pas prendre d’engagements contraignants et impopulaires dans leur électorat et auprès des milieux industriels.
La COP 21 de Paris aura-t-elle plus de succès que les vingt COP qui l’ont précédée ? Cela dépendra en grande partie des engagements des pays riverains du Pacifique dont six d’entre eux la Chine, les Etats-Unis, la Russie, le Japon, la Corée du sud et l’Indonésie sont au nombre des dix les plus forts émetteurs de gaz à effet de serre. C’est donc en grande partie sur les rives du Pacifique que se jouera le succès ou l’échec de la COP21.
Les pays riverains du Pacifique vont jouer un rôle majeur dans la lutte contre le réchauffement climatique.
Dans la multiplicité des pays qui bordent le Pacifique, on peut distinguer trois catégories : d’abord les pays industrialisés, ensuite la Chine et la Russie qui forment une catégorie à part et enfin les pays en voie de développement.
Les pays industrialisés, c’est-à-dire les Etats-Unis, le Canada, l’Australie, le Japon et la Corée du sud, ont vis-à-vis du réchauffement climatique une approche analogue.
Au départ, c’est-à-dire jusqu’au début des années 2000, tous étaient climato-sceptiques. Ils n’étaient pas convaincus que le réchauffement climatique était dû à l’activité humaine. Et même si quelques années plus tard, ils ont fini par admettre que l’homme avait sa part de responsabilité, ils ne croyaient pas que les Nations unies constituaient le cadre approprié pour traiter de ce phénomène. Ils ont donc refusé de ratifier le Protocole de Kyoto et ont préféré constituer un groupement régional.
Le 28 juillet 2005, le gouvernement des Etats-Unis a signé avec le Canada, l’Australie, le Japon, la Chine, la Corée du sud et l’Inde un accord appelé Partenariat Asie-Pacifique sur le développement propre et le climat, visant à développer de nouvelles technologies et l’adoption accrue d’énergie propre pour lutter contre l’émission de gaz à effet de serre. Beaucoup y ont vu une réplique au protocole de Kyoto que les Etats-Unis n’ont pas ratifié. Les sept Etats membres du Partenariat représentent environ la moitié de la population mondiale et produisent environ 65 % du charbon, 62 % du ciment, 52 % de l’aluminium et plus de 60 % de l’acier dans le monde. Ces pays sont générateurs d’environ 50 % des gaz à effet de serre.
Ce partenariat n’a pas donné les résultats escomptés et, après cinq ans, a pris fin en avril 2011, sans que, pendant son existence, les pays membres aient diminué leurs émissions de gaz à effet de serre.
Deux raisons essentielles expliquent cet échec.
D’une part certains pays membres de ce partenariat n’étaient qu’à demi-convaincus de la réalité du réchauffement climatique. Ils ne voulaient pas brider en quoi que ce soit des industries extractives et des modes de production, sans doute générateurs de CO2, mais situés au cœur de l’économie. C’était le cas des Etats-Unis du temps de la présidence de G.W. Bush. Le Sénat américain avait refusé de ratifier l’accord de Kyoto. La communauté américaine des affaires ne voyait alors aucune raison que les Etats-Unis se pénalisent vis-à-vis de leurs concurrents, et en particulier vis-à-vis de la Chine qu’ils estimaient beaucoup moins soucieuse de la préservation de l’environnement. L’attitude du Canada et de l’Australie était analogue, l’économie de ces deux pays dépendant pour une large part de leurs exportations de pétrole, de gaz naturel et de charbon. Le Canada, pour sa part, s’était retiré du Protocole de Kyoto.
D’autre part, le partenariat Asie-Pacifique n’avait aucun effet contraignant, à la différence du protocole de Kyoto. 175 projets ont été financés dans un partenariat public-privé entre 2006 et 2011 pour développer des techniques de production et d’extraction moins polluantes. Mais, malgré leurs bonnes intentions, les actions menées par le Partenariat n’ont eu que peu d’effets. Tout cela a conduit les pays membres à mettre fin à cette association qui, dès son origine, avait fait l’objet de critiques acerbes. Le Sénateur américain John McCain déclara que « le partenariat n’était rien d’autre qu’un stratagème de relations publiques » et l’Economist a décrit le partenariat comme « une feuille de
vigne masquant le refus des Etats-Unis et de l’Australie de ratifier le protocole de Kyoto ». Il serait exagéré de dire que l’opinion mondiale a été émue par cette disparition. En réalité, elle n’en a pas pris conscience.
Les Etats-Unis sont désormais conscients des contraintes imposées par le changement climatique.
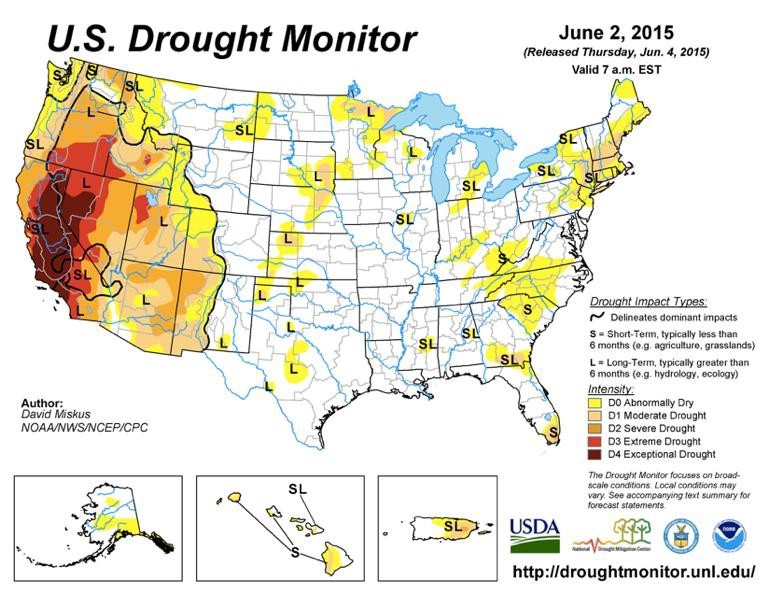
Premier émetteur de gaz à effet de serre pendant de très longues années jusqu’au moment où il a été détrôné par la Chine, les Etats-Unis figurent aussi au nombre des victimes du réchauffement climatique. La multiplication des cyclones, des tornades, des vagues de chaleur, la sécheresse qui persiste depuis plusieurs années dans certains états comme la Californie, la submersion des côtes dans le delta du Mississippi, la baisse du rendement des céréales dans les grandes plaines, tous ces phénomènes font que les Américains ne peuvent plus nier la réalité de l’élévation globale des températures. Le changement d’approche du gouvernement fédéral en est la conséquence. Jusqu’à la présidence Obama, les Etats-Unis ont d’abord nié que la cause était anthropique, puis ont refusé de s’associer au mécanisme financier pour aider aux changements indispensables des modes de production et d’utilisation de l’énergie.
Sous la présidence d’Obama, la position du gouvernement fédéral américain a totalement changé. Au climato-scepticisme et à l’hostilité à l’égard de l’ONU sous la présidence Bush, a succédé une volonté de participation aux mécanismes multilatéraux mis en place par l’ONU dans ce domaine. Lors de la COP19 de Varsovie en 2013, les Etats-Unis ont, comme les autres pays, accepté de mettre sur la table leur contribution nationale, c’est à dire de préciser lors de la prochaine COP, les mesures qu’ils comptent prendre à l’échelon national pour lutter contre le GES.
Quelles sont les mesures que les Etats-Unis comptent présenter à la COP 21 à Paris?
Dans le secteur de la production d’électricité, le Plan Clean Power entend réduire en 2030 de 32 % les émissions de CO2 par rapport à leur niveau de 2005. Le secteur de la production de l’énergie est responsable du tiers des émissions de GES aux Etats-Unis.
Les 3344 centrales électriques fonctionnant aux énergies fossiles dont 518 au charbon, 1101 au pétrole et 1725 au gaz naturel, sont, en effet, la première source de pollution du pays, occasionnant 31 % des émissions de gaz à effet de serre du pays, selon les chiffres de l’Agence de protection de l’Environnement pour 2013. Le secteur de la production charbonnière, qui ne manque pas de soutiens politiques, a fait valoir que ces mesures ne sont pas de la compétence de l’Etat fédéral mais de celle des états-membres. Il n’est pas douteux que les sociétés charbonnières mais aussi pétrolières vont s’engager dans une guérilla juridique pour faire échec à ce projet. De nombreux élus républicains ont d’ores et déjà manifesté une opposition farouche à ces projets
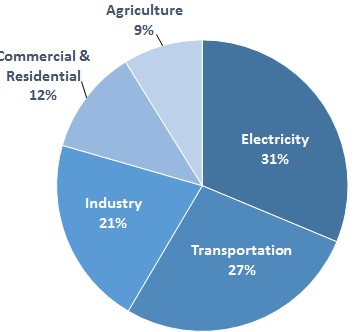
Le Canada veut encadrer le développement de ses ressources fossiles
Le Canada a radicalement changé de position.
Il avait été le premier pays à se retirer du Protocole de Kyoto en 2011 à la suite de la Conférence de Durban. Le gouvernement de M. Harper estimait que les engagements qu’il avait pris en signant cet accord étaient impossibles à respecter. En effet le Canada s’était engagé à réduire en 2012 ses émissions de GES de 6 % par rapport au niveau de 1990. La promesse n’avait pas été tenue. Les émissions avaient au contraire fortement augmenté.
Le Canada ne contribue que pour 2 % à l’émission de gaz à effet de serre (GES) mais, avec une population de 35 millions d’habitants, il est un des plus grands émetteurs du monde par habitant.
Par ses hivers rigoureux, par l’immensité de son territoire et le fort pourcentage d’énergie mobilisé par les transports, par l’importance des industries extractives (pétrole, gaz de schiste, sables bitumineux et houille), le Canada a un modèle économique dispendieux en énergie, même si 80 % de son électricité provient de ressources hydrauliques. Les responsabilités réglementaires dans le domaine climatique étant partagées entre provinces et gouvernement fédéral, il est utile de noter que les provinces de l’intérieur du pays (Alberta, Ontario, Saskatchewan) produisent plus de GES que les provinces de l’est et de l’ouest (Québec et Colombie Britannique) qui bénéficient de ressources hydro-électriques très importantes.
Les effets du réchauffement climatique sont perceptibles sur le territoire canadien avec le recul de la banquise toujours plus important l’été et le recul du pergélisol qui, en fondant, libère des quantités importantes de gaz à effet de serre (méthane). Pour autant, jusqu’à une date récente, le gouvernement canadien était opposé à prendre des engagements contraignants.
L’aggravation de ce phénomène est sans doute ce qui a incité le gouvernement canadien à changer d’approche. Il vient d’annoncer un certain nombre de mesures vis à vis des industries extractives. Le premier projet au monde de captage et stockage du carbone à grande échelle dans la centrale au charbon d’Estevan au Saskatchewan, ainsi que le premier projet de captage et stockage du carbone dans une installation d’exploitation des sables bitumineux, sont des exemples de puits de carbone, c’est-à-dire des réservoirs naturels ou artificiels qui permettent de stocker le carbone sans le rejeter dans l’environnement. De même le Canada a établi des normes rigoureuses concernant l’électricité produite à partir du charbon, normes qui interdisent la construction de centrales au charbon classiques et qui accéléreront l’abandon graduel des centrales existantes.
Dans le secteur des transports, qui est à l’origine d’environ 25 % des émissions de GES, le Canada, en collaborant étroitement avec les États-Unis, a adopté des normes qui seront de plus en plus rigoureuses pour les automobiles, les autobus et les camions.
L’ensemble des mesures annoncées montre de la part du gouvernement conservateur de M. Harper, un changement d’approche à l’égard de l’émission de GES. Voulant réduire d’ici 2020, 17 % les émissions de GES par rapport au niveau de 2005, le Canada est en phase avec les Etats-Unis et se fixe un objectif ambitieux. Si ambitieux que nombre de Canadiens doutent du réalisme et de la faisabilité de cet engagement.
L’Australie reste dépendante de son industrie minière.
Rejetant 1,3 % des gaz à effet de serre dans le monde mais étant un des plus gros émetteurs par habitant avec sa population de 23 millions d’habitants, longtemps décriée pour ne pas participer suffisamment à la lutte contre réchauffement climatique, l’Australie a annoncé qu’elle a l’intention de réduire de 26 % ses émissions de carbone d’ici 2030.
Là aussi on part de très loin. A la différence de son prédécesseur travailliste, le premier ministre australien libéral Ŕ c’est-à-dire conservateur – Tony Abbott, qui a quitté ses fonctions le 15 septembre dernier, faisait partie, il y a peu, des climato-sceptiques. Il ne pensait pas que l’éventuel réchauffement climatique qui, à son sens, restait encore à prouver, était dû à l’activité humaine. En revanche, il était convaincu que l’industrie minière est au cœur de l’économie australienne. Il était donc hostile à toute mesure limitant l’utilisation du charbon. A son arrivée au pouvoir en 2013, il avait mis fin à la taxe carbone instaurée l’année précédente par le gouvernement travailliste. De même, il avait réduit les subventions pour les éoliennes et les panneaux solaires. En revanche le nouveau premier ministre, M. Turnbull est convaincu depuis longtemps qu’il faut agir dès maintenant pour éviter la catastrophe climatique qui se produira si rien n’est fait.
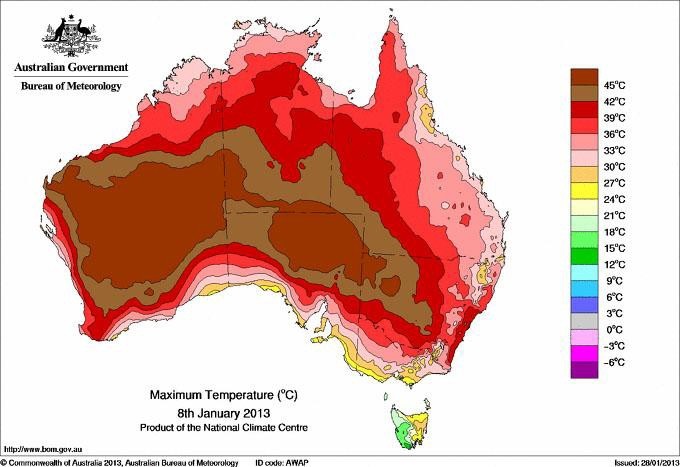
L’électricité australienne vient uniquement des centrales à gaz ou à charbon, l’hydroélectricité n’ayant qu’une part mineure dans ce pays sec. Le pays est viscéralement allergique au nucléaire. Il tire une grande partie de sa prospérité des exportations de charbon et de minerais.
La population australienne est sensible à l’environnement. Selon un sondage fait en juillet 2015, 70 % des électeurs australiens entre 18 et 34 ans pensent que l’Australie ne pourra pas maintenir une énergie reposant surtout sur le charbon et qu’une diversification sera nécessaire. En revanche il reste beaucoup à faire pour convaincre le monde des affaires et de l’industrie. Le gouvernement libéral, soumis à une réélection en 2016, veut démontrer à ses électeurs que l’Australie, jusqu’ici le mauvais élève de la classe des pays industrialisés, participe à l’effort commun et peut diminuer de manière significative ses émissions de CO2, sans payer le prix – qu’il juge exorbitant – de la taxe carbone créée par les Travaillistes. C’est pourquoi, pour rester dans la ligne suivie par les Etats-Unis qui ont promis une diminution en 2025 de 26 à 28 % de leurs émissions par rapport à 2005, et pour être compatible avec les engagements du Canada, inattendus par leur ampleur de 30 % de baisse en 2030 par rapport à 2005, l’Australie a proposé pour 2030 (donc cinq ans plus tard que les Etats- Unis) une diminution de 24 à 28 % par rapport à 2005, un chiffre ambitieux qui a surpris non seulement ses adversaires, mais aussi nombre de ses partisans.
Certains pensent même que l’ancien premier ministre, M. Abbott, ancien séminariste et catholique pratiquant, avait peut-être été influencé par l’encyclique papale « Laudato Si » de juin 2015 qui appelle à une action urgente sur le changement climatique et qui insiste sur le fait que ce problème ne peut être résolu sans une révision profonde des modes de consommation et de production et l’engagement déterminé des gouvernements dans le domaine de la politique énergétique. Cette encyclique rappelle aussi Ŕ ce qui est important – la dimension morale de la préservation de l’environnement.

Pollueur, l’Australie l’est indiscutablement. Mais elle est aussi victime. La Grande Barrière de Corail est le plus grand récif du monde. Elle s’étend sur 2600 km au large du Queensland, sur la côte est de l’Australie. Elle couvre une superficie de 340 000 km2. Cette Barrière classée par l’UNESCO comme faisant partie du patrimoine de l’humanité, est menacée par le réchauffement des eaux car nombre de coraux, qui vivent à la limite supérieure de tolérance à la température, blanchissent et meurent dès qu’elle est atteinte. La multiplication des cyclones tropicaux due au réchauffement climatique mais aussi les rejets des industries du Queensland et le projet d’exploitation de la mine de charbon de Carmichael et de création d’un port charbonnier à Abbott’s Point dans le nord du Queensland à deux pas de la Grande Barrière de Corail, sont autant de menaces pour un environnement jusqu’ici préservé.
Il n’est pas certain que l’Australie, compte tenu de sa dépendance aux énergies fossiles, de son absence de volonté de participer à un marché international de quotas de carbone et de son refus total de l’énergie d’origine nucléaire, soit en mesure de tenir intégralement ses promesses. Les engagements qu’elle compte prendre lors de la COP 21, restent cependant significatifs parce qu’ils témoignent d’un changement d’approche.
Le Japon reste traumatisé par Fukushima
Le Japon est le 5e émetteur de gaz à effet de serre au monde. Il faisait partie des pays réticents à
prendre des mesures limitant les gaz à effet de serre. A la demande du gouvernement un groupe de scientifiques japonais avait publié un rapport en 2009. Selon cette étude, le réchauffement de la planète n’était pas causé par l’homme mais par l’activité solaire et faisait partie d’un cycle climatique comme le monde en a connu dans le passé. Comme le Canada et les Etats-Unis, le Japon avait fait savoir que, compte tenu de ses contraintes nationales, il ne se sentait pas lié par le Protocole de Kyoto, pourtant signé sur son territoire.
A la suite de la catastrophe nucléaire de Fukushima, les 54 réacteurs nucléaires du pays ont été arrêtés. Le recours au charbon et au gaz naturel a été massif. Les émissions du Japon ont donc considérablement augmenté pour atteindre1,41 milliard de tonnes de CO2 en 2014.
Le plan de réduction des émissions nipponnes prévoit de faire appel aux énergies renouvelables (22% à 24%), tout en diminuant la part du nucléaire (20% à 22%) dans la production électrique du pays. L’archipel, très en pointe sur le photovoltaïque, comptera toujours beaucoup sur le charbon (26 %) et le gaz (27 %) pour fournir son électricité en 2030.
Cela ne suffira pas. Ce n’est sans doute pas du côté du Japon, toujours handicapé par les conséquences de Fukushima, qu’il faut attendre de grands progrès dans la réduction des émissions de gaz à effet de serre. Il est à noter que le Japon vient de relancer le redémarrage de centrales nucléaires.
La difficulté de la lutte contre le dérèglement climatique est avant tout pour chaque pays développé d’accepter que certains des modèles de croissance et que certains modes de vie doivent évoluer. Il n’est pas certain que l’Australie ou le Canada veulent, au fond d’eux-mêmes, changer de modèle de développement tant ils sont convaincus que depuis de nombreuses générations, l’histoire de leurs économies est une success story. Il en est de même pour les Etats-Unis. Il n’est pas certain que les Américains souhaitent modifier leur mode de vie et utiliser différemment leur voiture, tant la civilisation américaine est associée à l’automobile individuelle. C’est donc un problème d’acceptabilité par la population qui, si elle est de plus en plus convaincue que le climat se dérègle, n’est nullement persuadée qu’il faille pour autant changer ses habitudes.
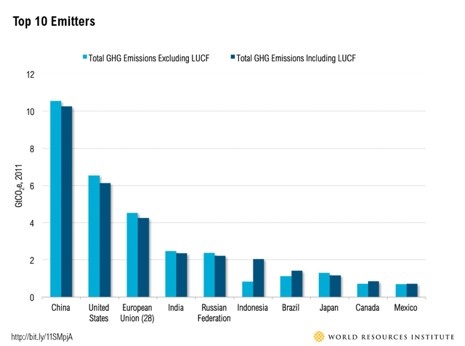
La Corée du sud a des objectifs modestes de réduction de ses émission
Avec un PIB de 1561 milliards de dollars prévu pour 2015 et une population de 50 millions d’habitants, la Corée du sud est devenue la 12ème puissance économique mondiale, devançant maintenant l’Australie qui est au 13ème rang. La Corée du sud est aussi au 12ème rang des émetteurs de GES. La Corée du sud ne figure plus depuis longtemps dans la catégorie des pays en voie de développement. C’est pourtant dans cette catégorie qu’on pourrait la ranger si l’on considère la modestie des objectifs qu’elle se donne en matière de réduction de GES. Elle se fixe comme objectif une réduction de 37 % de ses émissions en 2030 par rapport au niveau qu’elles auraient dû atteindre si la tendance actuelle se prolongeait.
Disposant de peu de ressources, le pays, qui dépend à 75 % des énergies fossiles, en importe la plus grande part. La Corée du sud avait lancé un programme nucléaire important pour diversifier les sources d’énergie et de limiter l’émission de GES. Elle dispose de 24 réacteurs nucléaires qui lui fournissent le tiers de son électricité. Cinq réacteurs sont en construction. Le gouvernement avait envisagé d’avoir 39 réacteurs nucléaires d’ici 2029, mais il n’est pas certain que ce programme soit exécuté, compte tenu des réactions de la population à la suite de l’accident de Fukushima.
Bien entendu la Corée du sud va développer son programme d’énergies renouvelables et prendre des mesures pour limiter la consommation des automobiles, notamment par la promotion des voitures hybrides.
Les pays marqués par le communisme : la Chine et la Russie.
Marqués par plusieurs décennies d’économie collectiviste qui ne se préoccupait pas de la préservation des ressources naturelles, la Chine et la Russie ont eu des difficultés à renouveler leur approche, mais paraissent maintenant plus soucieuses de jouer leur rôle dans la lutte contre le réchauffement climatique.
-
La Chine fait preuve d’un intérêt nouveau dans la lutte contre la pollution
Ayant, en 2014, supplanté les Etats-Unis comme première puissance économique mondiale en termes de pouvoir d’achat, avec 16,5 % de l’économie mondiale contre 16,3 % pour les Etats-Unis la Chine les devance aussi très largement dans le domaine des rejets de gaz à effet de serre. Avec respectivement 9,9 milliards et 5,2 milliards de tonnes de CO2 émises en 2013, la Chine et les Etats-Unis sont loin devant l’Union européenne (3,4 milliards), l’Inde (2,4 milliards) ou encore la Russie (1,8 milliard). Il est vrai que si l’on rapporte le chiffre des émissions de GES de la Chine au nombre de ses habitants, la Chine est loin derrière les Etats-Unis. Le même argument est utilisé par l’Inde, ses émissions de CO2 par habitant étant près de 20 fois inférieures à celles des Etats-Unis.
Avec son développement économique très rapide, son énergie électrique basée sur le charbon, la croissance de son industrie lourde, l’accroissement très rapide de son parc automobile, avec la pollution croissante de ses grandes villes qui est devenue un fléau, la Chine, qui jusqu’alors n’avait pas manifesté une préoccupation très forte pour la préservation de l’environnement et la réduction des gaz à effet de serre, fait preuve d’un intérêt nouveau dans ce domaine.
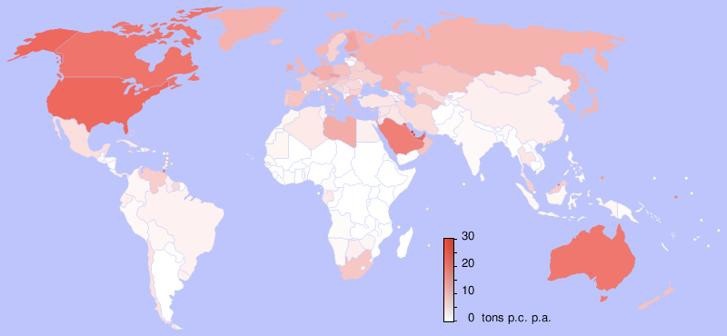
Emissions de gaz à effet de serre par habitant
Les engagements pris par le premier ministre chinois, lors de sa visite à Paris le 30 juin 2015, sont, de ce fait, particulièrement bienvenus. Il a annoncé que la Chine entend baisser son intensité carbonique de 60 %-65 % par rapport à 2005, porter la part de ses énergies primaires non fossiles à environ 20 % et augmenter son stock forestier à environ 4,5 milliards de mètres cube par rapport à 2005. Elle souhaite atteindre le maximum de ses émissions autour de 2030.
Il est bien évident que ce délai, qui est long, laisse de la marge au gouvernement chinois qui ne veut prendre aucun engagement qui briderait le développement économique de la Chine. Mais l’élément nouveau est que le réchauffement climatique d’origine anthropique est reconnu par la Chine.
Certaines actions des autorités chinoises ont eu un effet positif sur l’émission de CO2. Ainsi la Chine a mis en œuvre un projet d’une ceinture d’arbres de 4500 km entre le nord et le nord-ouest pour tenter de bloquer l’avancée du désert de Gobi. Depuis 2008, 13 millions d’hectares de forêt ont été plantés. Ce projet, connu sous le nom de Grand Mur Vert, serait le plus grand projet écologique mondial et aurait permis de compenser 85 % des pertes dues à la déforestation tropicale.
D’autre part, et dans un tout autre domaine, le nucléaire se développe. Provisoirement arrêtée en 2011 après la catastrophe de Fukushima, la construction de centrales nucléaires a repris. La Chine avait depuis 1983 et avec l’aide de la France, développé un programme nucléaire civil. Elle exploite maintenant 20 unités qui ont une production de 17,9 GW. 28 unités sont en construction d’une capacité totale de 30 GW. Cela représente le tiers des réacteurs nucléaires actuellement en chantier dans le monde. Les centrales sont maintenant de conception entièrement chinoise. Ce savoir-faire et cette technologie acquis auprès de partenaires étrangers, la Chine veut les valoriser. Elle figure désormais au nombre des pays exportateurs de nucléaire civil. Ces nouvelles centrales permettront à la Chine de devenir un peu moins dépendante du charbon. Mais tout cela doit être relativisé. La Chine s’est fixé pour objectif de porter ses capacités d’énergie nucléaire à 58 GW à l’horizon de 2020 contre 20,3 GW fin 2014, pour un coût estimé à 100 milliards de dollars. Même si cet objectif est atteint, le nucléaire ne répondra alors qu’à environ 6 % des besoins du pays en électricité (contre 75 % en France) selon l’Agence internationale de l’énergie.
La pollution atteint des pics dans les agglomérations chinoises. Elle suscite le mécontentement de la population. Elle a des incidences sur la santé publique. Voulant s’éloigner du modèle classique et obsolète du développement économique communiste fondé sur l’industrie lourde et l’utilisation sans contrainte du charbon, la Chine se sent maintenant une responsabilité particulière dans la lutte contre l’émission de gaz à effet de serre.
-
La Russie demeure réticente à l’adoption de mesures environnement
Pour l’URSS la préservation de l’environnement n’était pas une ardente obligation. C’est dans un mépris total pour les conséquences environnementales que le développement économique soviétique s’était bâti. Au début des négociations sur le climat, l’intérêt qu’y portait la Russie était des plus limités. En décembre 2003, le Président Poutine avait même déclaré que la théorie du réchauffement climatique était basée sur une erreur scientifique et que la Russie n’avait pas l’intention de ratifier le Protocole de Kyoto. Les Russes pensaient que la dislocation de l’URSS et la fin du communisme avaient généré de sérieux problèmes économiques et qu’il était beaucoup plus important de produire et de vendre du pétrole et du gaz naturel que de se consacrer aux questions écologiques. Le Protocole de Kyoto a pourtant été ratifié par la Russie en 2004.
Il y avait plusieurs raisons à cette ratification. L’une d’entre elles était que, voulant avoir sa candidature à l’OMC acceptée, la Russie voulait donner des gages de bonne volonté sur la lutte contre le réchauffement climatique. Une autre raison de cette ratification était qu’entre 1990 et 2001 les émissions de gaz à effet de serre de la Russie avaient chuté, du fait de la crise économique qu’elle avait traversée après 1990. De 2,4 milliards de tonnes en 1990 elles étaient tombées à 1,6 milliard en 2001. De ce fait, la Russie pouvait vendre à l’Europe des crédits carbone qui, pour les Etats européens, coûteraient moins cher que de fermer des centrales fonctionnant au charbon ou au pétrole. Même après la ratification du Protocole de Kyoto, la participation russe aux discussions était à la fois discrète et peu constructive. Ainsi à Doha en 2012, la Russie bloquait les négociations sur le climat en réclamant une compensation pour les « dommages » subis du fait de la pollution des pays occidentaux.
Une autre raison du changement d’attitude russe est qu’aspirant toujours à jouer les premiers rôles sur la scène internationale, la Russie, membre permanent du Conseil de Sécurité, a le souci de ne pas se retrouver marginalisée dans une négociation qui rassemble tous les pays du monde, notamment quand la Chine y prend une part importante.
Après la Chine, les Etats-Unis, l’Union européenne et l’Inde, la Russie est le cinquième émetteur mondial de GES. Ce pays commence à ressentir les effets du réchauffement climatique. Dans l’Arctique la fonte du pergélisol a une incidence sur les conditions de l’exploitation pétrolière et gazière. La sécheresse dans certaines parties du pays entraine des pertes importantes de récoltes. La pollution dans certaines villes génère des problèmes de santé publique.
L’objectif de la Russie est de réduire en 2030, de 20 à 25 % ses émissions par rapport à 1990. Elle compte le faire « par l’utilisation rationnelle, la protection, l’entretien des forêts et le reboisement » précise le document russe publié sur le site des Nations unies en vue de la COP21. En effet la Russie regroupe sur son territoire 70% des forêts boréales et 25% des ressources forestières mondiales.
Cela suffira-t-il pour atteindre l’objectif affiché ? Cela n’est pas certain car la Russie n’envisage pas d’autre mesure d’importance, ni sur la production d’énergie, ni sur son utilisation notamment dans les transports.
Les pays en voie de développement riverains du Pacifique.
Du plus grand, l’Indonésie, en passant par les Philippines, et en allant jusqu’aux micro-Etats insulaires du Pacifique, tous pâtissent du réchauffement climatique : les sécheresses, les inondations, les typhons, les vagues de chaleur se multiplient. Le niveau de la mer s’élève. Certains pays, comme l’Indonésie, ont une part de responsabilité. D’autres sont si petits qu’ils ne peuvent que subir les désagréments d’un phénomène dont ils ne sont aucunement responsables.
Le cas de l’Indonésie est révélateur des contradictions de nombreux pays riverains du Pacifique.
Avec ses 17000 îles dont 6000 sont habitées, et une grande partie de la population qui vit le long de la mer, l’Indonésie figure au nombre des pays les plus menacés par le réchauffement climatique et la hausse du niveau des mers. En 2008, l’Indonésie déclara qu’une vingtaine d’îles mentionnées sur les cartes avaient disparu et que 2000 des 17000 îles risquaient d’être submergées en 2040. L’augmentation de la température des mers diminue la ressource halieutique. Elle diminue également la récolte de riz qui, comme on le sait, est la base de l’alimentation de la population. Une augmentation d’un degré de la température moyenne diminue le rendement de 10% de cette production, selon l’Institut International de Recherche sur le Riz.
L’Indonésie a mis longtemps à prendre conscience de ces effets négatifs. Les forêts ont longtemps
été considérées comme inépuisables. La pratique de la culture sur brûlis a été vue comme une tradition difficile à éradiquer, malgré la pollution visible qu’elle engendre. Et l’extension de la culture du palmier à huile générateur de gaz carbonique, culture faite souvent sur des tourbières dont l’assèchement rejette dans l’atmosphère le CO2 et le méthane qu’elles stockaient, a été considérée comme une nécessité économique. Cependant leur effet négatif n’est plus nié par les autorités indonésiennes.
Le gouvernement indonésien n’est pas resté inerte. En mai 2009, lors de la conférence de Manado dans l’île de Sulawesi en Indonésie, l’établissement d’une zone transnationale de 6,5 millions de km² réunissant sept pays, l’Indonésie, Brunei, la Malaisie, les Philippines, la Papouasie-Nouvelle- Guinée, les îles Salomon et le Timor oriental, appelée Triangle du Corail, a été créée. Les pays concernés ont exprimé leur intention de mettre en œuvre des mesures de protection, de créer des aires marines protégées et de renforcer la lutte contre le braconnage. Outre la mise en place d’une gestion durable des ressources pour les 120 millions de personnes vivant dans cette zone, un des buts du Triangle est de renforcer la conservation et la connaissance de ces espaces maritimes qui comprennent 500 espèces de coraux et 3 000 espèces de poissons déjà identifiées, mais où des dizaines de milliers d’autres sont encore à découvrir, l’étude de ces régions restant très lacunaire.

Cet accord souffre toutefois de deux handicaps majeurs.
D’une part il n’inclut pas l’Australie pourtant très directement concernée avec les menaces qui pèsent sur la Grande Barrière de Corail.
D’autre part la zone protégée est immense (13 fois la superficie de la France) et les ressources pour mettre en œuvre des mesures de protection sont limitées, notamment pour la lutte contre le braconnage. Les forces de sécurité de ces pays sont mobilisées pour des urgences plus immédiates et politiquement plus sensibles que la lutte contre le braconnage ou la protection des espèces marines.
On peut ajouter que cet accord ne concerne pas les causes du réchauffement climatique mais seulement ses conséquences. Quelles initiatives et quels engagements l’Indonésie compte-t-elle prendre dans ce domaine ? L’objectif que s’est fixé l’Indonésie est de réduire ses émissions de 26 % d’ici 2018 par ses propres moyens et de 41 % d’ici 2020 avec l’aide étrangère.
Il est douteux cependant que ces objectifs très ambitieux soient atteints dans les délais annoncés et que les engagements, que ce pays prendra à Paris, aillent au-delà de l’expression d’une bonne volonté, dont la concrétisation ne pourra se faire que dans un avenir assez lointain.
-
Les pays d’Amérique latine sont davantage victimes qu’acteurs du réchauffement climatique.
La sécheresse qui frappe le Mexique, les fréquentes tempêtes en Amérique centrale, la montée des eaux qui engloutissent de vastes zones côtières, les nombreux glaciers andins qui régressent: autant de phénomènes qui traduisent un changement climatique à l’échelle du continent sud américain.
Le Mexique s’est fixé des objectifs juridiquement contraignants concernant la réduction des émissions. En vertu d’une loi adoptée en 2012, il entend réduire son empreinte carbone de 30 % d’ici 2020 et de 50 % d’ici 2050, un engagement très significatif pour un pays en voie de développement qui connaît une croissance rapide et qui est la deuxième économie d’Amérique latine.
Dans la compétition de la capitale la plus polluée, Mexico, 20 millions d’habitants et quinze fois Paris en superficie, serait sans doute bien placée, tout comme Pékin ou Djakarta. La pollution est surtout d’origine automobile. Des mesures de limitation de la circulation automobile et surtout des voitures ayant des moteurs anciens et donc polluants ont été mises en œuvre. Les voitures les plus anciennes ne sont plus autorisées à rouler certains jours par semaine, alors que les voitures neuves dont les moteurs ont moins de rejets de GES n’ont pas de limitation.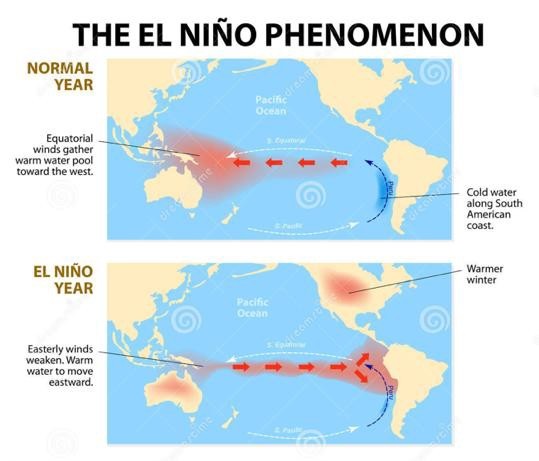
Les autres pays de l’Amérique latine contribuent peu au réchauffement climatique mais en revanche en sont les victimes notamment avec El Niño. On sait qu’il s’agit d’une inversion des courants marins qui se produit dans le Pacifique sud. En Indonésie et en Océanie, El Niño apporte un climat plus sec que d’ordinaire, qui peut entraîner sécheresses et incendies.
Du côté de l’Amérique latine, notamment au Pérou, au Chili et en Equateur, El Niño amène, au contraire, un air plus chaud et chargé en humidité qui entraine de très fortes précipitations dans des régions habituellement peu pluvieuses pouvant entraîner d’importantes inondations.
-
Les Etats insulaires ont un avenir hypothéqué par les conséquences du changement climatique.
Les Etats insulaires du Pacifique ne représentent que 0,03 % des émissions mondiales.

Les Philippines, cet archipel de 100 millions d’habitants, dont la plupart vivent le long des côtes, sont donc directement menacées par la hausse du niveau de la mer et par les cyclones. Mais les Philippines sont un pays en voie de développement qui pollue peu par rapport au nombre de ses habitants. Ce pays très peuplé doit affronter les mêmes problèmes que les micro-Etats insulaires du Pacifique qui sont frappés de plein fouet par la hausse du niveau de la mer qui oblige certaines populations à émigrer. C’est le cas des îles Tuvalu en Polynésie, Kiribati ou les îles Carteret en Papouasie-Nouvelle-Guinée. Ces pays subissent aussi l’accroissement du nombre et de la violence des cyclones. Parmi des dizaines d’autres, le cyclone Pam qui a dévasté Vanuatu le 13 mars 2015 en est un exemple.
Lors de la déclaration de Lifou en Nouvelle Calédonie le 30 avril 2015, les représentants de 15 micro-Etats ou territoires du Pacifique ont exprimé leurs craintes devant le réchauffement climatique. Ils ont constaté qu’ils ne contribuent que pour 0,03 % de l’émission des gaz à effet de serre. Mais ils subissent déjà de plein fouet les conséquences de l’élévation des températures.
L’avenir de ces îles est placé sous la contrainte du changement climatique et, pour certaines d’entre elles, il s’annonce sombre. Les pays ne sont pas égaux devant les effets du réchauffement. Les micro-Etats du Pacifique sont particulièrement touchés par la hausse du niveau de la mer qui menace les ressources en eau potable et réduit l’espace habitable.
Les Kiribati sont un archipel de 33 îles dont la plupart dépassent à peine le niveau de l’eau et sont régulièrement envahies par l’océan. Les habitants de Kiribati font partie des nations îliennes, avec les Maldives, Tuvalu et Tokelau, qui pourraient devenir « sans terre » à cause du réchauffement climatique, selon la Commission des droits de l’homme de l’ONU. Les études faites par le PNUD montrent que d’ici 2050 l’océan pourrait monter de 50 cm et d’un mètre d’ici la fin du siècle.
Le président des Kiribati envisage le déplacement de la population vers les Fidji et le Timor oriental si ces prévisions se confirmaient. Les îles Kiribati ont acheté aux Fidji 2000 hectares qui serviront pour l’agriculture si les infiltrations d’eau salée rendent toute culture impossible sur l’archipel.
Un agriculteur des Kiribati, dont les récoltes s’étaient effondrées à la suite des infiltrations d’eau de mer, s’est installé en Nouvelle-Zélande en 2007 et a demandé le statut de « réfugié climatique ». Ce statut vient de lui être refusé par la Cour Suprême de Nouvelle-Zélande. Celle-ci ne veut ni créer de précédent, ni encourager l’exode des 100 000 habitants des Kiribati, dont bon nombre affluent déjà en Nouvelle-Zélande et en Australie.
***
A six semaines de l’ouverture de la conférence sur le climat, les programmes des principaux acteurs Ŕ et donc des principaux pollueurs – paraissent aller dans le sens de la prise en compte du phénomène du réchauffement et de la volonté d’y remédier. Cinq des six Etats qui rejettent le plus de gaz à effet de serre sont riverains du Pacifique. La plupart de ces pays ont des programmes significatifs de réduction d’émissions. La lutte contre le réchauffement climatique va donc se jouer sur les rives du Pacifique.
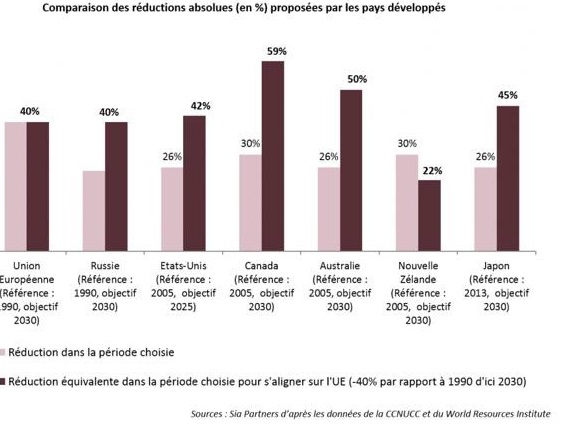
L’avenir dira si dans ce catalogue de bonnes intentions affichées et d’engagements vertueux, l’essentiel se concrétise. Mais entre les promesses et la réalité, il y a souvent une marge. Le Prix Nobel d’économie 2014, Jean Tirole a déclaré avoir « assez peu de foi dans les promesses dans le domaine de la lutte contre le réchauffement climatique ». Et un homme politique français récemment décédé disait que les promesses n’engagent que ceux qui les reçoivent. On peut en effet se montrer sceptique sur le respect de ces engagements tant que des mécanismes de contrôle indépendants et transparents ne sont pas installés. De plus il est à noter que le texte qui sera négocié lors de la conférence de Paris, ne mentionne pas la tarification du carbone qui est pourtant le vecteur essentiel d’une progression dans ce domaine. Une troisième pierre d’achoppement possible sera la matérialisation de l’engagement de 100 milliards d’euros tous les ans à partir de 2020 pour aider les pays en voie de développement.
La réduction des émissions de gaz à effet de serre est une entreprise de longue haleine. Ce n’est donc pas dans l’immédiat, mais dans la durée et au vu des rejets de carbone dans l’atmosphère, que les résultats de la COP21 pourront être évalués. Le succès n’est pas garanti.
Les remises en cause dogmatiques du réchauffement climatique ne sont plus de saison. Les engagements qui se profilent permettent d’être modérément optimiste sur une meilleure prise en compte des impératifs que nous impose le climat.
Alors peut-être, dans quelques années, serons-nous en mesure de répondre à la question posée par le Président Obama le 25 juin 2015 : « Plus tard, nos enfants et les enfants de nos enfants nous regarderont dans les yeux et nous demanderont : Avons-nous fait tout ce que nous pouvions, quand nous avions alors la possibilité de traiter ce problème, pour leur laisser un environnement plus propre, plus sûr et plus stable ? »
Comment concilier la croissance économique et la protection des systèmes océaniques
Jean-Michel DASQUE
Ancien ambassadeur en Papouasie-Nouvelle Guinée
(Intervention prononcée lors du colloque organisé le 9 juin 2015 au Sénat sur le réchauffement climatique)
Présentations générale de l’Océanie
Le Pacifique Sud désigne les espaces compris entre le 134ème méridien qui traverse l’île de Palau à l’extrême ouest de la Micronésie et à l’est le 109ème méridien sur lequel est située l’île de Pâques ou Rapa Nui, et si l’on considère la latitude, entre l’atoll de Midway au 28ème degré Nord et la pointe méridionale de la Nouvelle- Zélande, au 47ème degré de latitude Sud. On peut légitimement se demander si Timor et l’Irian Jaya, la partie occidentale de la Nouvelle-Guinée font partie de l’Océanie. Cette région recouvre près de 90.000 000 kilomètres carrés. Cet espace est essentiellement pélagique. Les terres émergées ne couvrent que 8.5 millions de kilomètres carrés. L’Australie elle-même forme un bloc continental mais la population se concentre dans les zones côtières et l’intérieur est quasiment vide d’habitants.
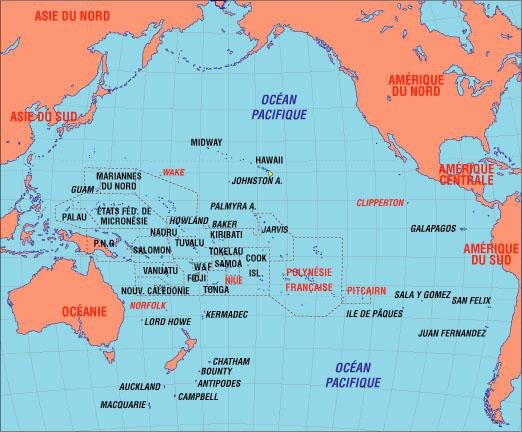
Les dimensions de ces Etats et territoires sont très inégales. L’Australie est un véritable continent (7.5 millions de kilomètres carrés). Les petits archipels de Polynésie et de Micronésie ne dépassent pas mille et parfois cent kilomètres carrés. La structure géophysique est également hétérogène. Les atolls coralliens ou soulevés par des mouvements tectoniques sont de faible relief (Mururoa, Kiribati, Tokelau, les îles Tobriand en PNG, Tuvalu) ; ils alternent avec des archipels volcaniques beaucoup plus élevés. La Nouvelle Guinée est le segment le plus oriental de l’arc montagneux himalayo-malais. La partie occidentale de l’Australie est constituée par des roches très anciennes, datant de l’époque archéenne (deux milliards d’années), des pénéplaines et des plaines alluviales.
La plupart de ces îles sont situées sur la ceinture de feu du Pacifique, à la jonction des plaques australienne et Pacifique ; elles se caractérisent par une intense activité volcanique et une instabilité tellurique. Elles sont exposées aux catastrophes naturelles, typhons, tsunamis, inondations et périodes de sécheresse provoquées par le phénomène du Niño.
Cette immense zone océanique est très peuplée. Elle compte au total 34 millions d’habitants dont plus de 90% vivent dans trois Etats, l’Australie, la Papouasie-Nouvelle-Guinée et la Nouvelle- Zélande. Les densités sont aussi très inégales. Elles varient entre 2.5 habitants au Kilomètre carré en Australie et 475 habitants à Nauru et 439 à Tuvalu.
Depuis Dumont d’Urville, les anthropologues divisent les populations autochtones en trois groupes. Les mélanésiens et les aborigènes australiens sont arrivés en provenance des îles de la Sonde, le Sund, entre 50.000 et 60.000 ans avant notre ère. Ils sont implantés dans les régions septentrionales et centrales de l’Australie et dans les grandes îles occidentales, Nouvelle-Guinée, îles Salomon, Vanuatu, Fidji. Les Polynésiens originaires de Taiwan et du Sud de la Chine ont pénétré en 0céanie entre 2000 et 1500 avant notre ère. Ils sont présents actuellement dans les îles centrales et orientales jusqu’en Nouvelle-Zélande, à Pâques et dans les îles Hawaï. Les Micronésiens sont assez proches par leurs traits physiques et leur culture des Polynésiens mais ils s’en distinguent par de nombreux métissages avec les populations asiatiques. Les Européens sont arrivés avec la colonisation et ils sont concentrés dans les zones tempérées, Australie, Nouvelle Zélande, Nouvelle Calédonie. Ils ont fait venir de divers pays d’Asie (Inde, Philippines, Indochine, Chine) des travailleurs immigrés dont la présence a accru la variété du peuplement océanien.
Des économies faibles et un environnement menacé.
faiblesse des économies
Des économies fondées sur des productions primaires, sensibles aux aléas des marchés.
L’économie du Pacifique Sud repose principalement sur le secteur primaire. Les peuples océaniens cultivent traditionnellement des plantes vivrières, arbre à pain, sagoutier, tubercules (ignames, patates douces, taros) et se livrent à l’élevage des porcs et de la volaille. Ils ont développé récemment les cultures de rapport, café, cacao, coprah, canne à sucre, palmier à huile. Les populations polynésiennes et celles des îles péricontinentales de Mélanésie pratiquent la pêche côtière. Le secteur manufacturier est peu développé. Il se limite à des usines de premier traitement des ressources naturelles, à quelques entreprises de radoub, des unités textiles et dans le secteur agro-alimentaire. Des conserveries de poisson ont été implantées à Pago Pago (Samoa) et à Honiara (îles Salomon). En définitive, les économies océaniennes reposent principalement sur l’exportation d’un petit nombre de produits de base dont les cours sont extrêmement fluctuants et sont par conséquent fortement dépendantes de la conjoncture des marchés mondiaux.
Des obstacles à la croissance
De sérieux obstacles s’opposent au décollage économique.
1- Obstacles d’ordre politique.
Les Etats insulaires ont accédé à l’indépendance à une date relativement récente et leurs frontières, dessinées en fonction des partages entre puissances coloniales, sont parfois artificielles (cas de l’Iryan Jaya, de Bougainville). Ils sont constitués de sociétés multiethniques et sont divisés en tribus et clans qui entretiennent souvent des rapports conflictuels. La colonisation a, comme on l’a vu, accru la diversité ethnique en favorisant l’immigration de populations asiatiques et la coexistence des communautés pose de sérieux problèmes. A Fidji l’antagonisme entre les mélanésiens, premiers occupants et la minorité indienne a provoqué des crises politiques graves et l’archipel a été le théâtre de quatre coups d’Etat au cours des trois dernières décennies.
Dans toute la région l’Etat est faible et manque de moyens. L’appartenance tribale l‘emporte sur le lien civique et la conscience nationale peine à s’affirmer. Les partis politiques nombreux dans les Etats mélanésiens n’ont pas de fondement idéologique ni de programmes. Ils sont créés sur une base clanique ou autour d’un leader charismatique, un « big man ». Militants et élus passent aisément d’un parti à un autre (cross the floor) et les crises ministérielles sont fréquentes. Les institutions sont minées par la corruption et la PNG occupe une des dernières places dans la liste établie par Transparency International. Enfin ces Etats manquent de cadres formés et doivent faire appel à des experts étrangers pour exercer des fonctions administratives ou techniques. Dans l’ensemble, les administrations océaniennes sont pléthoriques et inefficaces.
La faiblesse de l’Etat, l’incapacité de l’appareil répressif, les difficultés économiques et une urbanisation mal maîtrisée ont favorisé le développement de la criminalité. Des bandes de rascals, des jeunes souvent venus des campagnes, se sont formées dans les grandes agglomérations et Port Moresby, la capitale de la PNG, passe pour être une des villes les plus dangereuses au monde.
2- Les obstacles d’ordre géoéconomique
Les Etats insulaires souffrent de leur isolement, qui pèse lourdement sur le coût de transports, et explique en partie la cherté de la vie. Les collectivités françaises sont toutes à plus ou moins 24 heures d’avion et 40 jours de mer de la métropole. De plus les compagnies aériennes ou maritimes occupent souvent une position de monopole et pratiquent des tarifs élevés.
Les Etats insulaires, à l’exception de la PNG, se caractérisent par leur petite taille et l’étroitesse de leur marché intérieur. Cette situation leur interdit de réaliser des économies d’échelle, de développer des industries de substitution des importations et de diversifier l’appareil productif. De plus ces Etats sont des archipels dont les îles sont distantes de plusieurs dizaines et parfois de plusieurs centaines de kilomètres les unes des autres. Cet éclatement renchérit les déplacements intra-insulaires et engendre un développement asymétrique, caractérisé par la concentration des activités dans la capitale, souvent le seul port convenablement équipé, et la marginalisation des îles situées à la périphérie.
En troisième lieu, les économies insulaires souffrent de l’insuffisance des infrastructures, notamment dans les transports et les communications. La plus grande partie de la PNG est dénuée de routes et les transports se font exclusivement par avion. Le cabotage qui était florissant encore au lendemain de la guerre a périclité car cette activité a été abandonnée par les compagnies internationales ou régionales comme Ballande et des entreprises locales n’ont pas pris la relève.
Un quatrième handicap est constitué par le régime foncier. Les terres sont le plus souvent la propriété collective et inaliénable des tribus. Il n’existe aucun marché de la terre ni aucun cadastre. Ce système complique les opérations foncières et immobilières. L’acquisition par voie d’achat ou d’expropriation pour cause d’utilité publique ne peut être obtenue qu’au terme d’une procédure interminable et se révèle couteuse pour la puissance publique. Sur un autre plan, le régime foncier rend impossibles les emprunts hypothécaires et entrave développement d’une agriculture moderne de type capitaliste.
D’autres facteurs de blocage sont constitués par la pénurie de main-d’œuvre formée, son coût élevé compte tenu d’une productivité assez faible, la cherté des services de base, en particulier de l’énergie.
B- Un environnement menacé.
De sérieuses menaces pèsent sur un environnement souvent fragile. Les récifs coralliens ont été endommagés par les attaques des crown thorns, des espèces d’étoiles de mer géantes. Ils subissent une dégradation mécanique du fait des cyclones et sont affectés par le réchauffement et l’acidification de l’eau de mer qui provoquent le blanchissement et le dépérissement des polypiers. Ils sont enfin menacés par les activités anthropiques, urbanisation, installations touristiques, déversement d’eaux usées et de déchets polluants. Afin de protéger les coraux menacés de destruction, la France a lancé en 2004 l’initiative CRISP qui associe des Etats, des institutions multilatérales et des ONG. Les zones marécageuses où croissent les mangroves, qui jouent un rôle essentiel dans la protection de la biodiversité, sont asséchées et remblayées. La pêche industrielle à laquelle se livrent des sociétés étrangères, en employant des méthodes modernes telles que les filets dérivants, a fait des ravages et met en danger notamment deux espèces de thon, le thon jaune et le thon obèse. Plusieurs conventions destinées à protéger les espèces menacées1 ont été signées mais elles n’ont guère eu d’effet car elles comportaient des lacunes ou n’ont pas été ratifiées par certains Etats.
L’environnement terrestre est lui aussi dégradé. Les îles d’Océanie sont vulnérables aux pluies intenses et aux cyclones, cependant que les défrichages et les activités agricoles aggravent l’érosion des sols. Les entreprises de déforestation menées par des compagnies malaisiennes et coréennes, ont eu des effets dévastateurs sur les écosystèmes. Faute de mesures de précaution, les entreprises minières produisent des déchets toxiques qui sont déversés dans les rivières, les lagons ou les mers côtières, anéantissant la flore et la faune2. L’emploi massif des pesticides a également un effet polluant3.
Les archipels océaniens qui n’émettent que 0.03% du bioxyde de carbone (CO2) produit dans le monde subissent durement les effets du réchauffement climatique. La montée des eaux due principalement à la fonte des glaciers polaires et à l’expansion thermique des océans provoque une accélération de l’érosion des rivages marins, un recul du trait des côtes, la destruction d’infrastructures et pourrait, si aucune mesure n’était prise, engloutir les îles basses de Polynésie. D’ores et déjà les îles Carteret en PNG qui s’élèvent seulement à 1.20 mètres au-dessus du niveau de la mer sont menacées de disparition. Le changement climatique peut aussi accroître la fréquence et la violence des cyclones, provoquer des inondations plus graves, entraîner une salinisation des eaux douces, notamment des nappes phréatiques et réduire les ressources de la population en eau. Enfin il pourrait provoquer de nouveaux flux migratoires. Par mesure de précautions, le Président de Kiribati a acheté des terres à Fidji4, pour reloger ses compatriotes au cas où ils seraient obligés de quitter leur patrie à la suite de se submersion.
III-Promouvoir un développement respectueux de l’environnement
A- Des atouts qu’il convient de valoriser.
Les Etats insulaires possèdent certains atouts qu’il convient de valoriser. Les îles mélanésiennes ont des richesses minières importantes, cuivre, or et cobalt en PNG et en Iryan Jaya, nickel en Nouvelle- Calédonie, or et nickel aux Îles Fidji. En outre des gisements de gaz et de pétrole ont été découvertes en Papouasie-Nouvelle-Guinée et en Iryan Jaya. Il faudrait ajouter aux ressources naturelles l’exploitation du bois. Ces ressources peuvent servir de base à un début d’industrialisation (raffineries de pétrole, usines de liquéfaction du gaz et de traitements des minerais, ateliers de maintenance) et au développement des services (banques, assurances). En outre les activités pétrolières et minières génèrent des revenus pour l’Etat qui peuvent servir à financer des projets industriels, l’aide à l’agriculture et le développement des infrastructures.
D’ores et déjà le gouvernement de PNG a mis en place un fonds souverain destiné à financer des acquisitions d’actifs.
En second lieu, les Etats insulaires se sont vu garantir par le nouveau droit de la mer des zones économiques exclusives couvrant quelque 35 millions de kilomètres carrés dont 11 millions pour la France. Malheureusement leurs habitants, faute de posséder des flottes hauturières, ne sont pas à même d’exploiter les ressources halieutiques considérables que renferment les espaces pélagiques entourant leurs côtes. Loin de remédier à cette situation, les gouvernements ont préféré accorder des concessions à des sociétés étrangères, notamment japonaises, coréennes, américaines, qui leur versent des royalties. Cette politique devrait faire l’objet d’un réexamen. Il serait souhaitable de créer des entreprises performantes, de constituer des flottes capables d’opérer en haute mer, de former des équipages qualifiés mettant en œuvre des méthodes efficaces et respectueuses de l’environnement, de construire des conserveries. L’aquaculture offre aussi des perspectives prometteuses. D’ores et déjà des entreprises ont été créées dans les domaines de la perliculture et de crevetticulture en Polynésie et en NC. La biodiversité exceptionnelle du Pacifique Sud devrait permettre d’explorer d’autres filières telles que la pisciculture marine (élevage en cages flottantes), l’ostréiculture, la production de microalgues, de bêches de mer, de crabes, de pectens et de bénitiers.
Des marges de croissance existent aussi dans les domaines de l’agriculture et de la sylviculture. Bon nombre d’exploitations familiales utilisent encore des méthodes archaïques et destructrices de l’environnement. Des efforts devraient être menés pour perfectionner les techniques, accroître les rendements, freiner l’érosion des terres arables qui occupent des surfaces réduites, préserver les sites naturels par une politique de reboisement, assurer une gestion rationnelle de l’eau. Il faudrait par ailleurs veiller au respect des normes sanitaires et augmenter la capacité des installations de conditionnement. Dans un tout autre domaine il conviendrait d’identifier des niches de produits commercialisables sur les marchés extérieurs. Il faudrait éviter cependant que le développement des cultures de rapport se fasse aux dépens des cultures vivrières qui assurent l’autosuffisance des populations
Avec ses plages de sable fin, ses fonds marins tapissés de coraux et d’algues phosphorescentes, ses massifs montagneux, enfin un folklore riche et vivant quoique galvaudé, les Etats d’Océanie peuvent attirer les voyageurs venus des Etats industrialisés. Malheureusement seuls les territoires de Micronésie, surtout Guam ainsi que Fidji, ont su faire de l’industrie touristique une source de revenus. Ailleurs le développement de cette activité est freiné par l’éloignement, le coût élevé des frais de séjour et des transports5, l’insuffisance des infrastructures. Pour valoriser leur potentiel, les Etats insulaires devront augmenter les capacités d’accueil, améliorer les liaisons aériennes, réaliser des campagnes de promotion, exercer une vigilance accrue sur les prix. De toute manière les destinations vers le Pacifique seront pendant longtemps encore réservées à une clientèle aisée. Ceci n’est pas un mal car un tourisme de masse aurait un effet destructeur sur l’environnement. Une ultime remarque doit être formulée. Les classes moyennes de plus en plus nombreuses qui se forment en Asie constituent une clientèle au sein de laquelle se recruteront des touristes désireux de découvrir les rivages paisibles des mers Sud.
Les nations du Pacifique parlent une multitude de langues (plus de 1500 soit 25% des parlers connus dans le monde). Elles possèdent une culture, au sens ethnologique du terme, extrêmement riche. Les modes d’organisation sociale, les systèmes de parenté, les croyances religieuses, les rites d’initiation, les pratiques de dons cérémoniaux ont fasciné les anthropologues et ont servi de bases pour leurs constructions théoriques. Les arts primitifs d’Océanie ont produit des chefs d’œuvre (masques, statues, peintures) admirés et imités par des artistes occidentaux tels que Gauguin, Braque, Picasso, Modigliani. Ce patrimoine culturel et artistique doit être préservé et mis en valeur. Il constitue un attrait supplémentaire pour les touristes. En outre les savoirs traditionnels, qui sont protégés par des conventions internationales6, peuvent faciliter l’adaptation des peuples de la région à leur environnement extérieur, y compris au changement climatique.
B- L’exploitation de nouvelles ressources.
Le Pacifique Sud possède des ressources inexplorées mais qui pourraient devenir le levier d’un développement équilibré, respectueux de l’environnement.
1-Richesses des grands fonds marins.
Les explorations scientifiques ont révélé que les grands fonds de mers du Sud recélaient différents types de minerais dont certains intéressent les industriels. On peut citer :
-les sulfures polymétalliques hydrothermaux repérés à Wallis et Futuna et en NC ;
-les encroûtements de manganèse enrichis de cobalt, platine, terres rares ; les encroûtements les plus riches en cobalt actuellement connus se situent au Tuamotu, en Polynésie. D’autres gisements de métaux rares se trouvent aux large de la PNG ;
-des nodules métalliques enrichis en cobalt en Polynésie ; on en trouve aussi dans le centre du
Pacifique Nord et au large de l’îlot de Clipperton.
La mise en exploitation de ces ressources exige un effort de recherche dans trois directions : la technologie (fabrication d’un outillage adapté aux grandes profondeurs) ; une meilleure compréhension des mécanismes de minéralisation ; la connaissance géologique des grands fonds.
Les ressources en énergies fossile
Des réserves considérables de pétrole et de gaz ont été découvertes au cours des dernières années en PNG, dans la province sud des Highlands et dans le Golfe de Papouasie. Les experts pensent que d’autres gisements existent dans l’espace compris entre la NC et l’Australie. Les bassins sédimentaires qui jonchent cette zone ont pu générer en effet la présence d’hydrocarbures économiquement exploitables. Mais on ne possède pas les données de base indispensables pour pouvoir entreprendre des forages et des études supplémentaires en sismique, en géologie et géodynamique sont nécessaires.
La biodiversité.
Les pays du Pacifique Sud abritent une biodiversité exceptionnellement riche tant en milieu terrestre qu’en milieu marin7. Des recherches doivent être menées pour inventorier et valoriser ce patrimoine; elles doivent être orientées selon plusieurs axes :
- Acquisition de connaissances sur la biodiversité: enquêtes dans le milieu marin sur l’infiniment petit, les micro-organismes, les bactéries, les micro-algues, les plantes poussant à proximité des geysers sous-marins (hot spots) ; recherches sur les espèces végétales et animales, notamment des insectes, que l’on trouve dans les forêts primaires, les « rainforests ».
- Recherches en microbiologie à des fins de développement biotechnique (applications médicales, cosmologiques ou industrielles).
- Elaboration de systèmes d’observation, d’information, de bancarisation des données, de modélisation et d’aide à la g
- Optimalisation des modalités de conservation que sont les aires marines protégées et les parcs
naturels8.
C- Les nouvelles technologies.
Les nouvelles technologies peuvent pallier certaines déficiences structurelles des pays d’Océanie et favoriser un développement durable.
L’utilisation des énergies renouvelables peut être une contribution essentielle au développement dans une région où le coût de l’énergie est un handicap majeur. De multiples possibilités existent dans le domaine des énergies marines : énergie thermique des mers utilisant le différentiel de température entre les eaux profondes et celles de surface, système SWAC, éoliennes flottantes, énergie des vagues. Les énergies solaire et éolienne peuvent être d’une grande utilité dans les petits atolls où il est impensable d’installer une centrale électrique. L’énergie géothermique peut se développer dans des pays caractérisés par une vulcanologie active et la présence de sources d’eau chaude (y compris en NZ). Outre leur intérêt économique, ces énergies ont l’avantage de ne pas augmenter les émissions de bioxyde de carbone (CO2).
Dans un tout autre domaine les nouvelles techniques de l’information et de la Communication, si elles sont plus largement utilisées, atténueront les effets de la distance et éviteront des déplacements de personnes, toujours coûteux et compliqués. Elles permettront de moderniser les méthodes de l’administration, de la justice, de l’enseignement et amélioreront la productivité d’une bureaucratie lente et routinière. Elles contribueront à désenclaver des îles et des régions inaccessibles autrement que par avion ou par hélicoptère.
La protection des écosystèmes n’est pas incompatible avec une politique de croissance économique, tout au contraire. La préservation de l’environnement favorise le tourisme. Elle encourage des recherches qui peuvent se révéler utiles du point de vue économique et crée des emplois qualifiés. Elle peut aider à la naissance d’une agriculture et d’une pisciculture à haute valeur ajoutée et doit assurer la sécurité alimentaire. Plus important encore, l’Océanie est une réserve de biodiversité d’une richesse incomparable ; détruire ce patrimoine serait une perte irréparable pour l’humanité.
Retournement de la conjoncture économique en Amérique latine ; tensions politiques intérieures ; relations avec la France
par Jean-Michel DASQUE
Ancien ambassadeur en Papouasie-Nouvelle Guinée Point d’actualité du 26 mai 2015 (mise à jour au 20 Juin 2015)
Retournement de la conjoncture économique en Amérique latine ; tensions politiques intérieures ; relations avec la France
Retournement de la conjoncture économique
Entre 2000 et 2010, l’Amérique latine a connu une prospérité inégalée dans son histoire. Tous les pays sans exception ont vu leur production augmenter et leur niveau de vie s’élever. Le taux de croissance pour l’ensemble du sous-continent a été de 4.1% et il a même atteint 5% avant 2008. L’Amérique latine était devenue un « eldorado » très attractif pour les investisseurs étrangers. Ce résultat s’expliquait pour plusieurs raisons. Les pays situés au sud du Rio Grande ont bénéficié d’une conjoncture mondiale favorable et de la hausse des cours des matières premières, notamment des minerais et des hydrocarbures. La croissance a été tirée aussi par la demande de la Chine qui est devenue un des principaux clients de l’AML. Les gouvernements avaient pratiqué une politique financière volontariste, n’hésitant pas à emprunter pour financer des programmes d’investissements publics et soutenir la croissance. Nonobstant cette politique d’inspiration keynésienne, ils avaient eu le souci de maintenir le déficit budgétaire dans des limites raisonnables et d’éviter un alourdissement excessif de la dette. Ils avaient su habilement faire varier les taux de change pour stimuler l’exportation et les balances commerciales étaient équilibrées et souvent excédentaires. Ainsi les grands équilibres avaient été maintenus et l’inflation dans l’ensemble était restée modérée. Sur le plan extérieur la plupart des Etats de la région, qui étaient auparavant très fermés, ont pratiqué une stratégie d’ouverture commerciale ; cette orientation libérale a été illustrée par la conclusion de l’ALENA et les différents accords de libre-échange passés par le Chili1. Enfin la croissance a été soutenue par le dynamisme démographique et les économies ont assez bien résisté à la crise mondiale déclenchée par la faillite de Lehman Brothers.
La prospérité économique et l’aisance des finances publiques ont favorisé une diminution de la pauvreté et une augmentation de la classe moyenne qui représente maintenant 55% de la population. Au Brésil 40 millions de personnes sont sorties de la pauvreté au cours de la décennie 2000-2010.
Un retournement de tendance s’est produit à partir de 2010. Le taux de la croissance a baissé continuellement au cours des quatre dernières années et il est tombé en 2014 à 1,3%. Il devrait être de 0.9% en 2015 selon les prévisions du FMI2. Ce phénomène est dû en premier lieu au fléchissement des cours mondiaux des matières premières, spécialement du pétrole et des minerais et à la diminution de la demande chinoise. Le resserrement monétaire de la FED aux Etats-Unis a eu également un impact négatif sur la conjoncture latino-américaine car elle a augmenté le coût des financements externes et a provoqué une fuite des capitaux, notamment des dépôts à court terme. La dégradation des termes de l’échange, la diminution des marges bénéficiaires, l’incertitude politique et les troubles sociaux dans plusieurs pays ont incité les entreprises privées à comprimer leurs dépenses d’équipement. De leur côté les gouvernements, soumis à des contraintes budgétaires de plus en plus strictes, n’ont pas la capacité de mettre en œuvre des programmes d’investissements publics susceptibles de relancer la machine économique. La consommation, quant à elle, est restée asthénique à cause des risques de chômage, de la stabilisation des salaires, de la diminution des transferts et d’une hausse, assez modérée d’ailleurs, des prélèvements fiscaux. Le solde des échanges extérieurs est devenu déficitaire et l’inflation a refait son apparition3. La décélération de la croissance et la diminution de rentrées fiscales liée à la dégradation de la conjoncture risquent de remettre en cause les avancées sociales des années deux mille.
Par-delà les aléas de la conjoncture, les pays d’Amérique latine sont confrontés à des problèmes structurels. Les principaux sont les suivants :
-Le premier est la trop grande dépendance vis-à-vis des produits primaires (minerais, hydrocarbures, denrées agricoles) qui représentent 60% du total des exportations du sous-continent. La hausse des cours mondiaux pendant la première décennie du XXIème siècle a provoqué une « reprimarisation » des économies. Les industries manufacturières sont peu développées sauf dans quelques pays comme le Mexique notamment grâce à l’essor de « maquiladoras » et dans quelques Etats d’Amérique centrale (Salvador, Costa Rica). Quelques grands groupes se sont constitués au Brésil. Par contre, le secteur des PME est peu développé et ces entreprises trouvent difficilement accès au crédit.
-Les infrastructures et les services de base (routes, ports, aéroports, lignes électriques, approvisionnement en eau) sont très insuffisantes. Au Brésil, les camions s’accumulent dans les ports et attendent plusieurs jours avant de pouvoir être déchargés de leur cargaison. Les grands projets de voies transcontinentales sont pour la plupart en panne.
-La productivité se situe à un niveau très inférieur à celui des pays de l’OCDE et des pays émergeants. Il est nécessaire d’introduire les technologies nouvelles, d’améliorer la formation de la main d’œuvre et la gestion des entreprises, encore archaïque.
-Un quatrième frein à la croissance est constitué par l’insuffisance de la recherche. Les investissements dans ce secteur sont peu considérables (ils représentent 0.4% du PIB contre plus de 2% dans un pays comme le Japon) et sont financés essentiellement par l’Etat. L’investissement sur des fonds privés constitue à peine un quart du total de l’effort de recherche et de développement. Des institutions de recherche ont été créées au Brésil (la Fondation Vargas, le CEDRAP, un institut de recherches en sciences sociales dirigé par Enrique Cardoso) mais elles sont peu nombreuses dans les autres pays. Les investissements étrangers peuvent faciliter les transferts de technologie mais ils doivent être orientés vers les secteurs modernes de l’économie et l’innovation technologique.
-Le système éducatif est une autre faiblesse de l’Amérique latine. Sans doute les Etats ont-ils augmenté les dépenses consacrées à l’enseignement qui représentent 5% du PIB (5.6% pour l’ensemble des Etats de l’OCDE). Malgré cela des progrès doivent être réalisés. Si 91% des latino- américains en âge scolaire fréquentent les écoles primaires, 74% seulement reçoivent une éducation secondaire et 41% un enseignement supérieur 4 . La qualité de l’enseignement laisse à désirer (formation insuffisante des personnels, horaires inadaptés, équipement, notamment en informatique). L’enseignement privé (et payant) joue un rôle encore très important : il représente 40% des établissements au Chili5, 35% en Colombie.
- Le solde extérieur courant a été de -8 en2014 et il devrait atteindre -3% en 2015.
- Les taux sont 91% et 71% dans les Etats de l’OCDE.
- La présidente Michelle Bachelet a entrepris une réforme du système éducatif pour le rendre plus démocratique.
-La corruption est un mal endémique en Amérique latine et la plupart des pays sont très mal classés dans la liste établie par Transparency International. Ce point sera analysé avec plus de précision dans le chapitre suivant.
-Enfin les mesures prises au cours des quinze dernières années pour favoriser une redistribution des revenus n’ont pas permis de réduire réellement les inégalités ; selon le rapport de la Banque Mondiale « Inequality and lower growth in Latin America », l’Amérique latine est après l’Afrique subsaharienne, la région du monde où les inégalités sociales sont les plus criantes.
La situation varie considérablement selon les pays. Les Etats exportateurs de matières premières ont vu le rythme de leur croissance ralentir nettement tandis que ceux dont l’économie est plus diversifiée ont continué de bénéficier d’une conjoncture favorable.
Le Brésil, qui représente 40% du PIB de l’Amérique latine a été durement affecté par la diminution des importations de la Chine et par la baisse des cours des matières premières (pétrole, colza) qui représentent 50% de ses exportations ; son PIB devrait se contracter de 0.8% en 2015. En outre le pays connaît une forte inflation (7.7% en glissement annuel en février 2015) malgré un taux d’intérêt élevé (12.75% en mars) et le déficit des comptes publics est égal à 5.9% du PIB. Les investisseurs privés sont rendus très prudents par le climat des affaires assez médiocre, l’incertitude politique (impopularité de la président Dilma Rousseff) et l’importance de la dette des ménages6. Le souci de maitriser le déficit budgétaire et de juguler l’inflation conduit le gouvernement à faire des coupes dans les programmes d’investissements publics et à revenir sur certains avantages sociaux. Le marasme entraîne une augmentation de chômage : 50.000 emplois ont été détruits dans l’industrie au cours des deux dernières années et le taux de chômage est égal à 5.9% de la population active. Au-delà d’une conjoncture délicate, le pays est confronté à des faiblesses structurelles : capacité insuffisante des infrastructures de base, manque de travailleurs qualifiés, coûts de production trop élevés, lourdeur et complexité de l’administration et de la fiscalité, règlementation du travail trop tatillonne. Dans son rapport le FMI recommande des mesures pour améliorer la compétitivité des entreprises et attirer des investissements, notamment des IDE à long terme7.
L’Argentine est également fragilisée par le retournement de la tendance sur les marchés mondiaux de matières premières. Les exportations de soja se maintiennent mais les exportations d’énergie connaissent une diminution drastique. Les services, notamment le tourisme, marquent un essoufflement. Les restrictions aux importations ont contribué à désorganiser l’économie, elles ont freiné les investissements productifs et ont renforcé les tensions inflationnistes. Le pays qui a connu une quasi-stagnation en 2014 (0.5%) devrait enregistrer une faible progression en 2015 (1.1%.). Sur le plan financier, la limitation des montants de change autorisés a entraîné une explosion du marché parallèle et la hausse des prix a amputé le pouvoir d’achat de la population.
Au Venezuela les incohérences de la politique gouvernementale, la multiplication des contrôles administratifs, les expropriations de terres et les nationalisations, la gabegie et la corruption généralisées à tous les échelons ont provoqué une crise profonde. Dans le secteur industriel de nombreuses entreprises ont disparu et 80% des biens de consommation sont désormais importés. La PDVSA, la société pétrolière d’Etat, qui assure les deux tiers des ressources budgétaires, maintient sa production au niveau de 2.5 millions de barils par jour (contre 3 millions il y a dix ans) mais elle n’a pas les moyens de financer les investissements nécessaires pour mettre en valeur de nouveaux gisements. La chute du cours du pétrole a accru les difficultés, aggravé les pénuries, y compris des biens de première nécessité, poussé le taux d’inflation qui atteint 62% en 2014. Le PIB, qui a baissé de 4% en2014, devrait encore chuter de 7% en 2015. Le déficit budgétaire s’élève à 20% du PIB et la pauvreté qui avait diminué fait de nouveaux des progrès.
La situation est nettement plus favorable dans les pays andins. Le Chili est une des économies les plus dynamiques d’Amérique du Sud. Son PIB a augmenté en moyenne de 4.5% par an entre 2001 et 20118. La croissance a enregistré en 2014 un ralentissement important (+1.8%) dû au fléchissement du cours du cuivre, à la diminution de la demande chinoise, à un retournement des investissements dans le secteur minier et à une contraction de la consommation intérieure dans le contexte d’un endettement excessif des ménages. Cependant on ne doit pas être excessivement pessimiste. L’économie du Chili repose sur des fondamentaux solides, gestion rigoureuse des dépenses publiques, forte ouverture sur l’extérieur, richesses naturelles et le pays des Araucans devrait retrouver la voie de la croissance en 2015, année au cours de laquelle le PIB devrait progresser de 2.7%. Sur le plan politique, la présidente, Michelle Bachelet, a engagé plusieurs réformes importantes : réforme de l’éducation destinée à démocratiser l’enseignement, réforme fiscale, enfin révision de la constitution. Le Chili pratique une politique résolument libérale et a été un des fondateurs, avec le Pérou, la Colombie et le Mexique, de l’Alliance du Pacifique, qui vise à créer une zone de libre-échange et à développer la coopération économique et financière entre les Etats signataires.
Au Pérou, la chute des cours des matières premières (en 2014 les termes de l’échange étaient inférieurs de 12% à ceux de 2011) a provoqué aussi un ralentissement de la croissance en 2014 (2.4% contre 5.4% 2013 et 5.5% en 2012) et une aggravation du déficit des comptes courants qui atteint 6% du PIB en 2014. Les experts prévoient une amélioration (+3.8%) en 2015. La reprise sera favorisée par la politique volontariste des pouvoirs publics (programme de grands travaux) et par la mise en valeur de nouveaux gisements miniers (Torocho et Tia Bamba)9.Cependant ces projets suscitent une vive opposition de la part des communautés rurales qui redoutent des conséquences négatives pour l ‘environnement et l’agriculture.
Soutenue par la taille de son marché, sa démographie dynamique (47 millions d’habitants), enfin une réputation de débiteur scrupuleux, des ressources naturelles abondantes et variées (pétrole, charbon, émeraudes, café), la Colombie a connu plusieurs années de croissance ininterrompue : 6.6% en 2011, 4% en 2012, 4.3% en 2013 et 4.6% en 2014. Le Président Santos s’efforce de poursuivre les réformes de structures engagées par son prédécesseur Uribe et d’assainir les finances publiques. Il a fait voter une loi modifiant le système d’imposition des entreprises minières, établi un plafond pour le déficit budgétaire, adopté diverses mesures pour améliorer la productivité des entreprises et renforcer les infrastructures. Malgré une politique visant à soutenir l’activité économique, la baisse du prix du pétrole aura un impact négatif sur la croissance dont le rythme devrait être de 3.4% en 2015.
L’Equateur, qui avait stagné à la fin du siècle dernier, a enregistré une forte croissance au début des années 2000. Son PIB a progressé de 4.2% en moyenne par an et la hausse avait atteint 7.8% en 2011. Cependant la revalorisation du dollar, qui fait fonction de monnaie officielle, la chute du prix du pétrole et les restrictions aux importations ont eu un impact négatif sur la croissance qui est passée sous la barre des 4% en 201410. Sous la direction du président Rafael Correa, le gouvernement de Quito mène une politique nettement interventionniste. Il a mis en œuvre des programmes ambitieux, notamment dans les domaines des infrastructures, de la santé et de l’éducation et il a pris des mesures visant à une redistribution des revenus. Il a refusé d’adhérer à l’Alliance du Pacifique qu’il juge trop libérale. Cependant il a signé un traité de libre-échange avec l’UE.
En Bolivie la croissance continue d’être tirée par les exportations de minerais et d’hydrocarbures11. Malgré la baisse des prix mondiaux et une politique de nationalisations qui a pu dissuader les investisseurs étrangers, le PIB a continué d’augmenter en 2014 à un rythme soutenu (4.8%), quoique inférieur aux années précédentes (5.2% en 2011 et 6.4% en 2013). Le solde budgétaire est positif et les réserves de change confortables : 15 milliards de $ soit 50% du PIB. La dette extérieure est relativement faible 11.5 milliards de dollars (35% du PIB). Le gouvernement d’Evo Morales a mis en œuvre des mesures de redistribution (aides en faveur de la scolarisation, des personnes âgées, des femmes enceintes). Malgré tout, la Bolivie reste un des pays les plus pauvres du sous-continent.
Le Mexique dont le PIB a progressé de 2.% en 2014 devrait enregistrer une croissance de 2.6% en 2015. Bien que satisfaisant, ce chiffre est inférieur aux attentes parce que l’atonie de la demande et la politique monétaire restrictive ont atténué les effets positifs de la reprise aux USA. A plus long terme, la politique de libéralisation de l’économie, l’introduction de la concurrence dans les medias et l’ouverture de l’industrie pétrolière aux investissements privés devraient avoir un impact positif sur l’économie. La Banque Mondiale prévoit une croissance de 3.2% en 2016.
La baisse des prix du pétrole, une meilleure conjoncture aux Etats-Unis, le gonflement des transferts des travailleurs migrants (+9% en 2014), la mise en œuvre des accords de libre- échange passés avec plusieurs partenaires commerciaux (USA, UE) ont dopé la croissance dans les pays d’Amérique centrale. Ces facteurs ont aussi facilité les efforts de leurs gouvernements pour rétablir les équilibres de base (budget, échanges extérieurs). Au total les pays de l’Isthme ont connu une croissance de 4% en 2014 et devraient progresser de 4.2% en2015.
- Tensions politiques intérieures
Le retournement de la conjoncture économique s’est accompagné d’un regain des tensions politiques et de l’agitation sociale. Au Brésil, la classe politique a été éclaboussée par un énorme scandale car la direction de Petrobras a été accusée d’avoir détourné 3.4 mds d’euros pour financer la campagne électorale des partis politiques, notamment du Parti des Travailleurs, la formation de la Présidente, Dilma Rousseff. Treize sénateurs, vingt-deux députés, deux gouverneurs d’Etat, le secrétaire général du Parti du Travail, au total plus de quarante personnes auraient profité des largesses de la compagnie pétrolière brésilienne. La côte de popularité de Mme Rousseff qui atteignait 42% en décembre dernier, a chuté à 13%. Des manifestations ont réuni, notamment à Rio de Janeiro et à Sao Paolo, plus d’un million de personnes, qui protestaient contre la corruption et demandaient le retrait de la Présidente. Sans aller jusque-là, l’opposition menée par Eduardo Cunho demande un changement de politique et propose des mesures libérales : réduction des droits des salariés dans les entreprises, abaissement de la majorité pénale, libéralisation des ventes d’armes, modification de la législation sur l’extraction pétrolière et ouverture de ce secteur à l’investissement privé.
Un scandale a éclaté également au Chili. Le fils et la belle-fille de la présidente, Michelle Bachelet, auraient obtenu illégalement un prêt d’une banque d’Etat pour financer une opération immobilière de caractère spéculatif. Mme Bachelet nie toute implication dans cette affaire et entend réprimer sans faiblesse les actes de corruption. Par ailleurs le secrétaire d’Etat à la présidence,
- Jorge Insunza, a dû démissionner car, lorsqu’il était député, il avait conseillé des entreprises
- Le pays détient les deuxièmes réserves de gaz naturel du sous-continent, après le Venezuela, et les premières de lithium. Il produit aussi du cuivre et de l’éminières. C’est le deuxième membre du gouvernement de Mme Bachelet à donner sa démission en six mois. Malgré les remous provoqués par ces affaires, la présidente entend poursuivre les réformes de structure. Mais elle rencontre sur ce terrain aussi des difficultés. En effet bien qu’ayant élargi sa majorité avec l’entrée au gouvernement de communistes et de représentants des mouvements étudiants, elle n’a pas au Parlement la majorité des deux tiers nécessaire pour faire voter certaines des mesures qu’elle propose, notamment la révision de la constitution et devra donc négocier avec l’opposition.
En Argentine les partis favorables à Cristina Fernandez Kirchner ont remporté les élections parlementaires de 2013. Néanmoins, la présidente est critiquée pour son autoritarisme et les résultats médiocres de sa politique économique. Des grèves ont éclaté dans les services publics, y compris dans la police et des supermarchés ont été pillés à Cordoba. La loi sur la réforme de la justice a suscité des critiques de la part des milieux libéraux et certains articles ont été déclarés contraires à la constitution par le Cour Supérieure de Justice le 18 juin 2013. La loi sur les medias qui contraint les grands groupes de la presse, dont le groupe Clarin, à se séparer de certaines de leurs activités a également été censurée par le CSJ (23 octobre 2013). Enfin la mort, le 18 janvier 2015, dans des conditions mystérieuses du procureur Alberto Nisman, qui enquêtait sur l’attentat contre le centre culturel juif de l’AMIA en juillet 1994 a suscité un vif émoi dans l’opinion. Des organes d’opposition ont mis en cause les services secrets et reproché à Cristina Kirchner de n’avoir pas assuré une protection adéquate du magistrat.
En Equateur, le président Rafael Correa reste populaire et il a été réélu triomphalement à la tête de l’Etat le 17 février 2013. Cependant sa décision prise, en octobre 2013, de mettre en exploitation le champ pétrolier de Yasuni, une réserve naturelle située au cœur de l’Amazonie, a déçu les militants écologistes. Par ailleurs la loi du 14 juin 2013 visant à réguler les medias et empêcher une trop forte concentration dans ce secteur, dominé par des groupes proches de l’opposition, inquiète les cercles libéraux. Le mécontentement d’une fraction non négligeable de la population explique le revers subi par le parti gouvernemental aux élections municipales organisées en 2014. A l’issue de ce scrutin les trois principales villes, Quito, Guayaquil et Cuenca sont passées aux mains de l’opposition.
Au Mexique le pacte conclu entre les trois principaux partis de gouvernement12 été rompu car le PRD d’Andres Lopez Obrador, situé à gauche sur l’échiquier politique, rejette les projets libéraux du président Peña Nieto. Par ailleurs un climat d’insécurité est entretenu par les cartels de la drogue qui sont parfois de connivence avec des éléments de l’administration et de la police. En septembre 2014, quarante-trois étudiants ont été tués par des bandits à la solde de la municipalité d’Iguala dans l’Etat de Guerrero et le 22 mai 2015 une fusillade entre un convoi de police et un groupe armé a fait 43 victimes à la frontière entre les Etats du Michoacán et de Jalisco. Des abus sont imputés également aux groupes d’autodéfense villageois et le gouvernement a décidé de confier à la gendarmerie la lutte contre les trafiquants de drogue. Malgré les remous provoqués par les scandales divers, le parti gouvernemental, le PRI, a remporté un net succès lors des élections législatives et pour les postes de gouverneur organisées le 7 juin.
Les négociations engagées en 2012 entre le gouvernement du président de Colombie, Juan Manuel Santos, et la guérilla marxiste des FARC se sont poursuivies à La Havane et un accord est intervenu sur plusieurs points de l’ordre du jour (développement rural, garanties accordées à l’opposition). Cependant les problèmes les plus épineux (intégration de guérilleros dans la société civile, droit des victimes, lutte contre le trafic de drogue) restent à résoudre. Le 11 avril un commando de rebelles a tué une dizaine de soldats dans une embuscade dans le Cauca. L’armée a riposté en bombardant un camp d’insurgés, faisant une vingtaine de victimes. Poursuivant l’escalade, les FARC ont annoncé le 22 Mai, leur décision de mettre fin à la trêve unilatérale et illimitée décrétée cinq mois plus tôt. Ces incidents fournissent des arguments aux dirigeants politiques, dont l’ancien président Alvaro Uribe, opposés au processus de paix.
Après le décès d’Hugo Chavez, Nicola Maduro Moros, qui exerçait les fonctions de Vice- président, a été élu le 14 avril 2013 à la présidence du Venezuela. Mais il a obtenu une faible majorité
(50.6 % des voix) et le scrutin a été contesté par l’opposition menée par H. Capriles. En décembre de la même année, le parti gouvernemental, le PSUV, a gagné les élections municipales mais l’opposition a remporté la mairie de plusieurs agglomérations importantes dont Caracas, Valencia et Maracaibo. L’agitation étudiante s’est développée en 2014 et des manifestations, durement réprimées par des miliciens favorables au régime, ont éclaté en avril de cette année. Plusieurs adversaires politiques du président, dont Leopoldo Lopez, leader du Parti Populaire, ont été arrêtés. Enfin le Président Maduro a décidé d’établir un contrôle très strict sur les médias, notamment les médias étrangers, s’attirant les critiques des organisations internationales, notamment de Reporters sans frontières. La chaîne colombienne NTN 24, CNN ainsi que la chaîne nationale Globovision ont été les victimes de la censure des autorités gouvernementales.
- Relations avec la France
Sous le mandat de Nicolas Sarkozy les pays d’Amérique latine avaient été quelque peu délaissés. Les responsables de notre diplomatie n’avaient guère montré d’intérêt réel que pour la Colombie où le sort d’Ingrid Betancourt était suivi avec attention et pour le Brésil où le Président de la République fit un voyage officiel. Encore doit-on préciser que les espoirs commerciaux placés dans ce dernier pays avaient été déçus car les négociations pour la vente de Rafales n’avaient pas abouti. Les rapports avec le Mexique s’étaient, quant à eux, sérieusement, refroidis à cause de l’affaire de Florence Cassez.
Les gouvernements formés après l‘élection présidentielle de mai 2012 ont une diplomatie plus dynamique et font de l’Amérique latine, selon les paroles de Laurent Fabius, « un objectif majeur de la politique étrangère française (Déclaration de M Laurent Fabius au Figaro (20 février 2013) ». M. François Hollande a désigné M. Jean-Pierre Bel, ancien président du Sénat, comme son envoyé spécial en Amérique latine. Le chef de l’Etat a fait un voyage officiel au Mexique (10-11 avril 2014) et s’est rendu récemment à Cuba où il a rencontré Raul Castro et son frère Fidel ainsi qu’en Haïti. En février 2013 le ministre des Affaires Etrangères a effectué une tournée au Pérou, au Panama, en Colombie. Le Premier ministre effectue à partir du 20 juin un voyage en Colombie et en Equateur. Plusieurs chefs d’Etat et ministres latino-américains (Equateur, Bolivie, Colombie) ont séjourné à Paris où la Présidente du Chili a été reçue en visite officielle les 8 et 9 juin. Le Président du Mexique est attendu pour le 14 juillet. Cette sollicitude pour l’Amérique latine est justifiée par trois raisons principales. Le gouvernement entend maintenir une présence culturelle importante et ancienne (275Alliances françaises accueillant 160.00 étudiants, 37 lycées français, plusieurs milliers d’étudiants latino-américains en France, un système de bourses) ; il souhaite que les Etats latino-américains deviennent des alliés dans les enceintes multilatérales (conférence de Paris sur le réchauffement climatique) ; enfin sa stratégie est motivée par des raisons économiques. La France est en termes de flux le premier investisseur étranger en Amérique latine et elle a obtenu de grands contrats, notamment dans le domaine des armements. Mais la situation du commerce de biens courants est moins brillante et la part de marché de notre pays ne représente que 1.5%. Le gouvernement s’est fixé pour but d’augmenter les échanges de biens et de services et de renforcer la présence des PME.
Construire un Etat : L’ONU au Timor oriental.
Par Jean-Christian CADY
Préfet honoraire
Ancien représentant spécial adjoint du secrétaire général des Nations Uniesau Timor oriental chargé de la gouvernance et de l’administration publique
Quand en novembre 1999, j’ai dit à mes amis que je partais au Timor oriental dans une mission de maintien de la paix, la plupart d’entre eux m’ont dit : « Je ne voudrais pas paraître ignorant mais, dites-moi, où se trouve le Timor ? » Il est vrai que pour les Français, le Timor est toujours resté en dehors du champ de leurs préoccupations, de leur zone d’influence et de leur histoire.

Dans le long chapelet des îles de la Sonde qui s’étend sur 3500 km d’est en ouest, et dont la plupart forment l’Indonésie, le Timor est l’une des îles qui se situent le plus à l’est. Le Timor est à 2000 km à l’est de Djakarta et à 600 km au nord-ouest de Darwin en Australie. Le Timor est proche de l’équateur, à 5 degrés de latitude sud. A la différence des autres îles de la Sonde, ce n’est pas une île volcanique. Mais c’est une île montagneuse. Le plus haut sommet atteint près de 3000 m. La capitale Dili a 150 000 habitants et n’a aucun titre de gloire internationale, si ce n’est que les amateurs de littérature se souviendront peut-être que l’écrivain navigateur Alain Gerbault est mort à Dili en 1941. Le Timor est une île au climat chaud et humide où sévit la malaria. Elle est à l’écart des grandes routes maritimes. Bien qu’un certain nombre d’endroits de la planète puisse prétendre à ce titre, le Timor est un peu le bout du monde.

Dans son livre « une île au loin », l’écrivain timorais Luis Cardoso décrivait le Timor oriental comme « une île jetée au bout du monde et laissée à l’abandon » Vous allez me dire : mais pourquoi s’intéresser au Timor oriental, cette moitié d’île perdue au fin fond de l’Insulinde ? Pourquoi s’intéresser au Timor oriental qui ne fait que la moitié de la superficie de la Belgique et qui ne rassemble qu’un million deux cent mille habitants et qui est parmi les pays les plus pauvres du monde ? Pourquoi ? Parce que c’est un cas d’école. C’est le seul pays qui ait accédé à l’indépendance sous l’égide de l’ONU et où l’ONU a été obligé de tout créer ex nihilo. Dans l’histoire assez chaotique des missions de maintien de la paix où les succès sont peu nombreux, c’est l’une des très rares réussites. Et enfin parce qu’il est intéressant de voir 12 ans après l’indépendance, et après tous les efforts et l’argent qui y ont été consacrés, ce que le Timor est devenu.
C’est ce que je me propose de vous décrire en commençant par un peu d’histoire.
Le Timor avait été découvert par des navigateurs portugais en 1511. L’île a 30 000 km2 et est partagée en deux moitiés : la partie occidentale dont le dernier colonisateur était les Pays-Bas, fait partie maintenant de l’Indonésie. La partie orientale, qui a été colonisée de manière ininterrompue par le Portugal pendant plus de quatre siècles, est maintenant indépendante. La composition ethnique du Timor oriental est complexe car elle résulte de vagues de migrations successives depuis 3000 ans. Elle peut être schématisée de la manière suivante.
A l’apport initial mélanésien venu de l’est, c’est à dire de populations analogues à celles que l’on trouve en Papouasie, Nouvelle Guinée, se sont ajoutées des populations malaises venues de l’ouest. L’est du Timor oriental est resté à l’écart de ces vagues migratoires et est donc, malgré de nombreux métissages, assez proche des ethnies de Nouvelle Guinée.
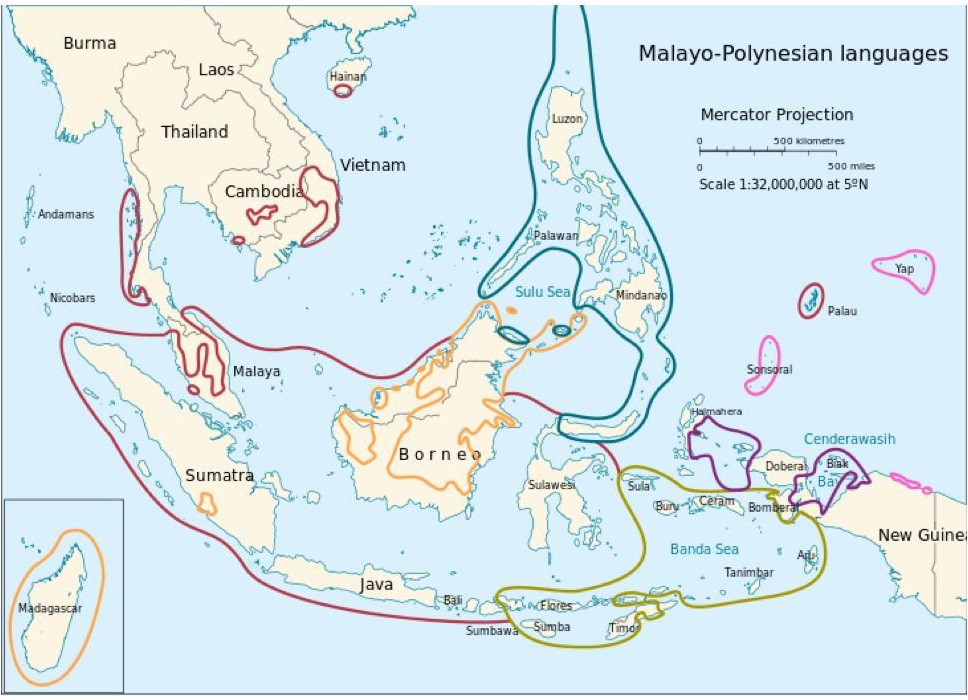
Le corollaire de cette diversité ethnique est la diversité linguistique. Une douzaine de langues sont parlées au Timor. Elles appartiennent à deux grands groupes. Le groupe malayo-polynésien, très vaste groupe linguistique qui va de Madagascar jusqu’aux îles du Pacifique et le groupe des langues papoues qui compte au Timor oriental six langues différentes parlées par 250 000 personnes.
L’histoire de ces quatre siècles et demi de colonisation portugaise est complexe. Si l’on veut retenir l’essentiel, on peut se limiter à trois points :
- le premier est qu’à partir du 17 e siècle les Hollandais et les Portugais se sont disputés le Timor. Depuis le XVIIIe siècle jusqu’à 1949, la partie occidentale de l’île a été colonisée par les Hollandais Un accord en 1859 et une décision de la Cour de La Haye en 1914 ont entériné la partition entre une moitié ouest hollandaise et une moitié est portuga Comme les partitions sont rarement parfaites, au milieu du Timor occidental qui était néerlandais se trouve l’enclave d’Oecussi qui était portugaise. La moitié néerlandaise est devenue indépendante en 1949 en même temps que le reste de l’Indonésie. Le reste du Timor, y compris l’enclave d’Oecussi est resté une colonie portugaise jusqu’en 1975.J’ajoute que l’ensemble de l’île du Timor est en majorité catholique.
- Le deuxième point est qu’au Timor oriental la présence portugaise ne mobilisait que peu d’effectifs. C’est en jouant les tribus les unes contre les autres, en ayant des alliances temporaires et variables avec l’une ou l’autre, que les Portugais, avec une garnison qui n’a jamais dépassé 800 hommes, ont réussi à se maintenir plus de quatre siècles. Lorsque les populations se rebellaient, la répression était dure. En administrant peu, le Portugal n’a pas fait grand chose au Timor. Peu de routes. Il n’y avait aucune route goudronnée en dehors de la capitale en 1975. Le Portugal avait construit quelques bâtiments publics et s’était contenté de tirer quelques maigres profits de la culture du café et de l’exploitation du bois de santal.
- Le troisième point est que dans ce pays compartimenté et montagneux où les ethnies sont très différentes, parlent une douzaine de langues différentes et ne se comprennent pas entre elles, l’église catholique a été un puissant facteur de cohésion. Le Timor oriental est catholique à 85 %, le reste de la population étant animiste. L’affluence dans les églises est grande. Comme toujours et comme partout, l’Eglise a investi dans l’éducation. Les élites timoraises sont très largement composées d’anciens élèves des écoles catholiques. L’enseignement y est dispensé en portugais même si les offices, les sermons et la catéchèse sont faits dans une langue parlée à Dili, la capitale : le tetum.
Du fait de son éloignement, du fait aussi que les ressources limitées du Portugal étaient mobilisées par des parties de son immense empire colonial moins éloignées de Lisbonne, le Timor était une terre d’exil où, du temps de Salazar, on envoyait les fonctionnaires dont les opinions étaient jugées séditieuses. Nombre de ces fonctionnaires portugais se sont unis à des Timoraises et ont fait souche. La plupart des leaders actuels de Timor sont de sang mêlé. A la veille de la Deuxième Guerre Mondiale, le Timor oriental demeurait ce qu’il avait toujours été pendant quatre siècles : oublié du monde, assoupi dans son sous-développement et sa chaleur équatoriale.
La Deuxième Guerre Mondiale a sorti le Timor de sa torpeur. La moitié occidentale, colonie néerlandaise était de ce fait engagée dans la guerre. En revanche, le Timor oriental, colonie portugaise n’aurait pas du faire partie du conflit puisque, comme on le sait, le Portugal était resté neutre. Toutefois au moment de leur avancée maximale, les troupes japonaises envahirent l’ensemble du Timor le 20 février 1942, voulant s’en servir comme tête de pont pour attaquer l’Australie. Le Portugal, hors d’état de s’y opposer, accepta qu’un détachement australien vienne combattre les Japonais dans la jungle timoraise. Les Timorais apportèrent une aide non négligeable aux Australiens. Mais les Australiens, dépassés par les troupes japonaises, furent obligés de se retirer, en février 1943. Les Timorais et les Portugais stationnés au Timor payèrent au prix fort leur aide aux Australiens : entre 40 000 et 70 000 personnes moururent. Les Japonais restèrent au Timor jusque début septembre 1945, quelques jours après la capitulation du Japon.
Les Portugais reprirent alors leur place au Timor oriental, alors que les Néerlandais eurent plus de difficultés. Le mouvement de décolonisation dont les graines avaient été semées par les Japonais dans tous les pays qu’ils avaient occupés – y compris en Indochine – touchait les Indonésiens qui, après une guerre coloniale assez courte, obligèrent les Hollandais à leur donner l’indépendance. Rien de tel ne se produit au Timor oriental dont les habitants, à l’époque, ne désiraient pas l’indépendance. A la différence de ce qui s’est passé en Angola ou au Mozambique où il y a eu des guerres coloniales du temps de Salazar, il n’y a pas eu de lutte pour l’indépendance au Timor. L’indépendance n’était pas alors la préoccupation des Timorais. Ce n’est qu’en 1974, au moment de la Révolution des œillets, que le Portugal décida d’accorder l’indépendance à toutes ses colonies, y compris le Timor.
Cette indépendance fut très mal gérée par le Portugal et conduisit à une guerre civile. Trois partis se formèrent en 1974: l’UDT (l’union démocratique du Timor) qui était en faveur du maintien du lien entre le Timor et le Portugal avec pour objectif l’indépendance dans quelques années, le FRETILIN (Front de libération nationale) qui était marxiste et voulait l’indépendance immédiate et l’APODETI (l’association populaire démocratique du Timor) très minoritaire qui voulait le rattachement à l’Indonésie. La guerre civile se déclencha en août 1975. Mieux armé, mieux organisé, ayant réussi à mettre la main sur les armes de la garnison, le FRETILIN marxiste eut le dessus.
Le gouverneur portugais quitta Dili et se réfugia dans l’île d’Atauro à 15 kilomètres de Dili. Le pouvoir était vacant. Sans attendre qu’un processus de transition soit mis en place, le FRETILIN proclama l’indépendance du Timor oriental le 28 novembre 1975.
L’indépendance dura 9 jours. Pour mieux lutter contre le FRETILIN, les deux autres partis firent appel à l’Indonésie, mettant en avant le risque d’établissement d’un régime marxiste au Timor. Avec la neutralité bienveillante des Etats-Unis et de l’Australie, l’armée indonésienne entra au Timor. Elle ne devait en repartir que 24 ans plus tard. L’Indonésie annexa le Timor en juillet 1976 qui devint la 27e province de son territoire. Cette annexion ne fut pas reconnue par l’ONU, pas plus que par aucun Etat de la communauté internationale. Seule l’Australie reconnut cette annexion, sans doute mue par un désir de se rapprocher de l’Indonésie qui est son voisin immédiat. Mais cette initiative lui fut longtemps reprochée. Diverses résolutions du conseil de sécurité demandèrent à l’Indonésie de mettre fin à cette occupation et restèrent sans effet.
Une chape de plomb s’abattit sur le Timor. Tous ceux qui avaient été en faveur de l’indépendance s’exilèrent soit vers l’Australie toute proche, soit vers le Portugal, soit pour ceux dont les sympathies étaient le plus à gauche, vers l’Angola ou le Mozambique. Rares furent ceux qui choisirent de poursuivre sur place, dans la jungle, la lutte armée contre l’envahisseur indonésien. Lutte d’ailleurs condamnée à l’échec, tant était flagrante la disproportion des forces et la violence de la répression indonésienne qui passait au napalm tous les villages qui avaient apporté une aide à l’armée de libération.
Le rapport de Human Rights Data chiffre à 102 000 le nombre de morts dus à la répression indonésienne durant les 24 années d’occupation. Imaginons cela. Sur une population qui comptait alors seulement 600 000 habitants, un sixième est mort. Le Timor a été bouclé comme une prison. Aucun journaliste, aucun étranger n’y était admis. On ne savait pas ce qui s’y passait.
Il est intéressant de noter que pendant l’occupation indonésienne, l’église catholique a été la seule institution à survivre. Elle a fortement contribué à donner au Timor son identité, développant une langue nationale, le tetum qui remplaça le portugais dans les offices. Elle a aussi participé à maintenir le Timor dans le champ de visibilité de la communauté internationale, la visite du Pape Jean-Paul II au Timor en 1989 y ayant contribué. Le résultat est qu’alors que l’église catholique regroupait le tiers seulement des Timorais sous la colonisation portugaise, 95 % des Timorais se déclaraient catholiques en 2000.
En 1992, après avoir passé 15 ans dans la jungle du Timor à la tête de la guérilla, Xanana Gusmao le leader du FALINTIL, l’armée de libération timoraise, fut capturé par les forces indonésiennes et condamné à l’emprisonnement à vie. Cette sentence fut, quelques mois plus tard, commuée en 20 ans de prison devant l’opprobre de la communauté internationale. L’action pour l’indépendance allait se déplacer surtout sur le terrain politique et diplomatique, avec à l’extérieur José Ramos Horta, journaliste
qui essayait de mobiliser les chancelleries en faveur du Timor et à l’intérieur Mgr Belo, évêque de Dili, dont la voix portait d’autant plus que, face aux occupants indonésiens musulmans, les Timorais avaient un regain de ferveur catholique, ce qui était une façon d’affirmer leur identité. Ramos Horta et Belo reçurent le prix Nobel de la paix en 1996 ce qui a contribué à ramener au premier plan de l’actualité, la situation du Timor auquel, mis à part le Portugal, peu de pays s’intéressaient.
En 1999, ce qui était attendu depuis longtemps mais paraissait toujours improbable, se produisit. Depuis 1998, l’Indonésie avait un nouveau président Youssouf Habibi qui avait succédé au dictateur Suharto. Las de soutenir à bout de bras le Timor où l’Indonésie avait beaucoup investi et en pure perte, le nouveau président indonésien décida d’accepter l’idée d’une consultation du peuple timorais sur un projet d’autonomie
élargie et d’admettre la possibilité de l’indépendance en cas de rejet de cette option. Le référendum était programmé pour le 30 août 1999. Auparavant, le conseil de sécurité envoya une mission destinée à faire le recensement de la population, dresser les listes électorales et, le jour du vote, vérifier la régularité des opérations.
Malgré des tentatives d’intimidation des milices pro-indonésiennes pour empêcher les électeurs de voter, le référendum s’est déroulé dans le calme et avec 78 % des suffrages exprimés, a donné un résultat massif en faveur de l’indépendance.
Les choses se sont immédiatement gâtées. Lorsque les Indonésiens ont évacué le Timor oriental, dans les semaines qui ont suivi le référendum, les milices timoraises pro-indonésiennes ont avec l’appui, la logistique et la planification de l’armée indonésienne, détruit systématiquement le pays. Des massacres ont eu lieu. Environ 1600 Timorais pro-indépendance ont été tués dans des opérations qui ont quelque
analogie avec ce que la France a subi en 1944 à Oradour-sur-Glane. La volonté des Indonésiens a été de détruire tous les équipements qu’ils avaient construits durant les 25 années où ils avaient occupé le Timor : les postes, les centres de télécommunication, l’aéroport de Dili, les bâtiments publics, les hôtels. Presque tout a été incendié. Les maisons étaient détruites. Le Timor était en cendres.
Le 15 septembre 1999, émue par les massacres qui se multipliaient, l’ONU décida de créer une force multinationale à dominante australienne INTERFET pour intervenir au Timor et refouler milices et troupes indonésiennes vers le Timor occidental. La retraite des troupes indonésiennes se termina le 30 octobre. Elles laissaient derrière elles un pays totalement dévasté. Le conseil de sécurité de l’ONU créa le 25 octobre 1999, par la résolution 1272, l’administration temporaire des Nations unies au Timor oriental (UNTAET dans le sigle anglais et ATNUTO en français).
J’ai été un peu long dans cette description historique mais il était indispensable de vous rappeler le contexte dans lequel la mission des Nations unies a été créée.
*
* *
Cette mission avait plusieurs caractéristiques. J’en relève cinq principales.
- un mandat d’une ampleur sans précédent
- une tâche immense.
- une multiplicité d’acteurs internationaux.
- une Tour de Babe
- une implication croissante mais difficile des Timora
Un mandat d’une ampleur sans précédent.
La Résolution 1272 du Conseil de Sécurité du 25 octobre 1999 crée une Administration transitoire des Nations Unies au Timor oriental (ATNUTO), à laquelle est confiée la responsabilité générale de l’administration du Timor oriental et qui est habilitée à exercer l’ensemble des pouvoirs législatif et exécutif, y compris l’administration de la justice. Vous avez bien entendu : l’ensemble des pouvoirs exécutifs, législatifs et celui de l’organisation de la justice. Il n’est pas exagéré de dire
que le représentant spécial du secrétaire général des Nations Unies au Timor oriental avait donc, au moins dans la phase initiale, des pouvoirs de nature despotique. Un despote éclairé en quelque sorte.
Et comme si cela n’était pas suffisant, le paragraphe suivant de la Résolution 1272 détaille les principales tâches de la mission :
- Assurer la sécurité et le maintien de l’ordre sur l’ensemble du territoire du Timor oriental ;
- Mettre en place une administration efficace
- Aider à créer des services civils et sociaux ;
- Assurer la coordination et l’acheminement de l’aide humanitaire, ainsi que de l’aide au relèvement et au développement ;
- Appuyer le renforcement des capacités en vue de l’autonomie ;
- Contribuer à créer les conditions d’un développement durable ;
Cette énumération n’était pas exhaustive. La Résolution 1272 ne mentionnait pas des tâches
pourtant essentielles comme la rédaction d’une constitution, la création d’institutions administratives et financières, d’une fonction publique, d’une banque centrale, d’une police, d’un système éducatif avec le recrutement d’un corps enseignant et la construction d’écoles, d’un service postal et de télécommunications etc. J’en oublie certainement.
Une tâche immense.
En effet et c’est là le deuxième point sur lequel il faut insister : la tâche était immense.
Quand je suis arrivé à Dili, la capitale du Timor début décembre 1999, la ville était déserte. Les Timorais avaient trouvé refuge dans les montagnes pour fuir les exactions des milices. D’autres, plus de 100 000, étaient partis avec les Indonésiens, certains parce qu’ils avaient
collaboré de près avec l’administration indonésienne. Mais la majorité de ceux qui étaient partis au Timor occidental, avaient été emmenés contraints et forcés dans les fourgons de l’armée indonésienne. Ils étaient parqués dans des camps de réfugiés au Timor occidental où ils vivaient dans le plus grand dénuement et étaient rackettés par les milices qui faisaient régner un ordre mafieux reposant en grande partie sur la terreur. La plus grande partie des réfugiés ayant été emmenés de force, souhaitaient rentrer chez eux au Timor oriental. Ils voyaient qu’au Timor occidental ils n’étaient ni attendus, ni accueillis et que leur avenir n’était pas dans la société indonésienne.
Au Timor oriental, tout était à faire. Trois choses étaient particulièrement urgentes : éviter la famine, redonner un abri aux populations et assurer la sécurité. Et sur le plan local, les ressources étaient inexistantes.
Le plus urgent était l’aspect humanitaire et en particulier d’éviter la famine. Durant la période allant de septembre à décembre 1999, le Programme Alimentaire Mondial, et les ONG comme CARE, Caritas et World Vision ont apporté de l’aide à 610 000 personnes déplacées. C’est à dire la quasi totalité de la population. Ces distributions étaient réparties en fonction des besoins, beaucoup plus pressants dans les districts qui avaient subi le plus de destructions et également dans l’enclave d’Oecussi, séparée du Timor oriental.
Prévenir la propagation des épidémies était une autre urgence. Avec la Croix Rouge Internationale et l’action d’ONG, on put parer au plus pressé et éviter des catastrophes sanitaires.
Tout aussi urgente était la nécessité de redonner un toit à ceux qui avaient tout perdu. Des milliers de toiles de bâche bleues aux couleurs de l’ONU furent distribuées pour protéger les familles des pluies torrentielles de la mousson. Et avec des parpaings et de la tôle ondulée, la reconstruction des maisons commença.
Assurer la sécurité dans un territoire menacé par l’anarchie et où la loi de la jungle risquait de prévaloir était une urgence absolue. On ne peut rien construire de solide quand la sécurité n’est pas établie. Dans l’immédiat les militaires maintenaient l’ordre. Les nombreuses patrouilles d’INTERFET avec des engins blindés dans la capitale Dili, les nombreux barrages instaurés sur les grands axes, qui donnaient à cette ville l’apparence de l’état de siège, impressionnaient les populations et les rassuraient à la
fois. C’était non seulement un élément de dissuasion contre un éventuel retour des milices pro- indonésiennes mais aussi un élément de confiance pour les populations qui voyaient dans cette force armée l’instrument de leur libération. Mais il fallait très vite créer une police civile et une justice, les militaires ne pouvant ni faire des enquêtes policières, ni détenir des suspects dans la durée et encore moins prononcer des jugements.
Troisième caractéristique de la mission : L’action internationale reposait sur une multiplicité d’acteurs et tout d’abord sur UNTA
UNTAET était dirigée par le représentant spécial du secrétaire général de l’ONU. Il était brésilien et s’appelait Sergio Vieira de Mello. Il avait fait toute sa carrière aux Nations Unies, avait été dans plusieurs missions de maintien de la paix, notamment celle du Cambodge. Fils d’un diplomate brésilien qui avait été en poste en Italie et en Espagne, il était un ancien élève du Lycée français de Rio de Janeiro. Il parlait à la perfection cinq langues : la sienne le portugais, celle des pays ou il avait vécu,
l’italien, l’espagnol, le français – il avait d’ailleurs une maîtrise en philosophie de la Sorbonne – et enfin l’anglais. Avec une aisance confondante, il passait de l’une à l’autre en fonction de ses interlocuteurs. Son énergie et ses qualités de diplomate étaient telles que beaucoup voyaient en lui
un futur secrétaire général de l’ONU. Le destin ne le lui a pas permis puisqu’il a été tué dans un attentat suicide qui a détruit le QG de la mission de l’ONU à Bagdad en août 2003.
UNTAET comprenait trois piliers. D’abord un pilier militaire.
Le conseil de sécurité avait, dans sa Résolution 1264 du 15 septembre 1999 créé une force militaire de maintien de la paix dénommée INTERFET (International Force for East Timor) qui a regroupé 11 500 militaires venant de 22 pays, dont 5 500 fournis par l’Australie. Le commandant d’INTERFET était le général de division Peter Cosgrove, qui est devenu, il y a quelques mois, gouverneur général de l’Australie. INTERFET a joué, dans les premier mois de la mission, un rôle décisif, puisqu’elle était la seule entité pouvant non seulement assurer la sécurité extérieure et intérieure du Timor, mais aussi disposer de moyens logistiques utiles sur le plan de la distribution de l’aide humanitaire.
En février 2000, INTERFET a été intégrée dans UNTAET devenant ainsi le pilier militaire de cette mission.
Le pilier de la gouvernance et administration publique était responsable de la création des structures du futur Etat.
C’est celui que je dirigeais. C’est le pilier qui était responsable de l’administration de la justice et du système pénitentiaire, de la création et de la gestion de la fonction publique, de la création et de la gestion des institutions économiques et financières dans le domaine de la monnaie, du crédit, des impôts, du budget, du paiement des dépenses publiques, de l’éducation nationale, de la santé, de l’agriculture, des transports, de l’administration territoriale, de la planification, de la rédaction du code pénal et de procédure pénale, de la préparation des lois, de la rédaction de la constitution. C’était de loin le plus complexe. Il comprenait 1640 policiers internationaux, 1600 personnels civils internationaux sous le statut des Nations Unies et plus tard, quand nous avons pu les recruter et les former, 1900 personnels civils timorais. Le pilier gouvernance et administration publique avait pour tâche essentielle de préparer le Timor a être indépendant et à s’administrer lui-même. Les chiffres
que je mentionne peuvent paraître élevés puisque en tout 6000 personnes relevaient du pilier que je dirigeais. Mais ce qu’il faut bien voir, c’est que les civils n’arrivent pas comme les militaires. Les militaires arrivent en unités constituées avec armes et bagages. Les civils arrivent individuellement, recrutés un par un par l’ONU à New York. Le service du personnel de l’ONU n’était pas préparé à un recrutement aussi massif, d’autant plus que l’ONU avait d’autres opérations en cours, en particulier celle du Kosovo. Cette arrivée au compte-gouttes nous a handicapés.
Enfin le pilier humanitaire.
La coordination de l’aide humanitaire était la première urgence de la mission. Redonner un toit à ceux qui n’en avaient plus, apporter une aide alimentaire pour empêcher la famine qui allait s’installer, apporter une assistance sanitaire pour éviter les épidémies, étaient des missions essentielles.
Ce sont des tâches que l’ONU a l’habitude de faire dans la plupart des missions de maintien de la paix et pour lesquelles elle a une expertise indéniable. Après une année
d’activité qui a été considérée comme un succès, le pilier humanitaire a disparu, le Timor n’étant plus considéré comme se trouvant dans une situation d’urgence. Les ONG sur lesquelles l’ONU s’appuyait pour faire fonctionner des dispensaires et des hôpitaux et une présence médicale et sanitaire sur le territoire, sont encore restées quelque temps mais nombre d’entre elles sont reparties assez rapidement, étant appelées sur d’autres points du globe par d’autres urgences. Les attributions permanentes du pilier humanitaire, c’est à dire la santé, le logement et l’alimentation furent ensuite absorbées par le pilier gouvernance et administration publique.
Autour d’UNTAET gravitaient une multiplicité d’organisations internationales avec des agendas différents. Elles appartenaient à quatre cercles.
- Le premier cercle était celui des organisations des Nations Unies, c’est à dire le PNUD (programme des Nations unies pour le Développement), le PAM (Programme Alimentaire Mondial) l’UNICEF, l’OIM (organisation Internationale des migrations). Ces organisations, chacune dans leur domaine, apportaient une aide précieuse et n’avaient pas et n’essayaient pas de définir une politique autonome, différente de celle d’UNTAE
Il n’en était pas de même pour les trois autres cercles.
- Le deuxième cercle était formé par les organisations créée en 1944 par les accords de Bretton Woods : le Fonds Monétaire International et la Banque Mondia S’y ajoutait la Banque Asiatique de Développement créée en 1966. Elles avaient chacune leur hiérarchie, leurs circuits de décision, leurs priorités, leurs circuits de financement et ne se considéraient pas comme subordonnées à UNTAET. Il en résultait souvent une concurrence dommageable et, vis à vis des Timorais, une incohérence apparente qu’elles essayaient de mettre à profit en jouant l’un contre l’autre.
Deux exemples concrets : la Banque Mondiale essaya d’importer au Timor un programme qu’elle avait mis en œuvre en Indonésie qui s’appelait community empowerment program, qui consiste à essayer de fédérer des énergies dans des villages autour de réalisations menées par les villageois eux-mêmes, réalisations financées par la Banque Mondiale. Les décisions étaient prises par l’assemblée du village. Ce fut un échec. La Banque Mondiale n’avait pas réalisé que, dans ces villages traditionnels, les décisions sont prises par le chef du village et que la consultation des villageois ne se fait pas comme dans un conseil municipal occidental.
Deuxième exemple : celui de la monnaie. Au début de la mission, quatre monnaies circulaient au Timor : la roupie indonésienne, le dollar australien qui était la monnaie acceptée dans les magasins qui s’ouvraient et dont les propriétaires étaient australiens, l’escudo portugais car quelques anciens fonctionnaires timorais du temps de la colonisation portugaise recevaient encore une pension en escudos et enfin le dollar américain qui était la monnaie dans laquelle les personnels d’UNTAET étaient rémunérés. Le FMI a insisté pour que la monnaie du Timor soit le dollar américain alors que la valeur faciale de cette monnaie était beaucoup trop élevée pour la majorité des transactions au Timor.
- Troisième cercle international : les organisations gouvernementales des pays voulant aider le Timor, par exemple AUSAID l’agence australienne de développement, USAID l’agence américaine de développement, DFID (Department for International Development qui est l’agence britannique), JICA (l’agence japonaise de coopération). Elles étaient utiles et même indispensables mais bien entendu chaque agence avait sa propre politique, ses propres priorités. Je me contentais de les réunir de temps en temps pour leur donner un compte-rendu d’activité et leur exposer quels étaient nos be
- Enfin le quatrième cercle était formé par les ONG. Elles étaient soucieuses de leur indépendance. Disons le tout de suite : sans ces ONG, ou du moins sans certaines d’entre elles, des secteurs entiers n’auraient pas été couve Leur action était absolument indispensable dans les domaines de la santé, de l’aide alimentaire, de la production agricole, de l’éducation. Mais essayer de les coordonner pour éviter les doublons ou pour tenter d’établir une carte d’implantation des dispensaires sur l’ensemble du territoire du Timor était un défi. Ayant leur propre financement, soucieuses de leur indépendance et jalouses de leurs prérogatives, elles étaient foncièrement individualistes et répugnaient à toute forme de coordination qu’elles voyaient comme une ingérence.
- Quatrième caractéristique de la mission : Une Tour de Babel
La mission qui avait une quatrième caractéristique propre à toutes les missions de maintien de la paix : C’était Une Tour de Babel.
Une mission de maintien de la paix comme celle du Timor oriental regroupait des acteurs appartenant à 56 nations. La diversité des nationalités fait que la mission est une Tour de Babel où la lingua franca est l’anglais. Sur le plan du travail, tout se passait en anglais parlé avec les accents les plus divers. Le nombre de langues parlées par les Timorais était un obstacle supplémentaire. Cette diversité de langues a été un handicap dans la communication avec les Timorais. Nous devions nous reposer sur des interprètes dont la bonne volonté n’arrivait pas toujours à pallier les défaillances linguistiques.
Le journal officiel du Timor, où se trouvaient consignées les décisions prises par le gouvernement, était publié en quatre langues : l’anglais, puisque c’était la langue de la mission et celle dans laquelle le texte avait été élaboré, le portugais puisque c’était la langue de la plupart des membres du conseil national de la résistance, l’indonésien puisque une partie des membres du conseil consultatif ne parlaient que cette langue qui avait été enseignée depuis 24 ans dans les écoles du Timor, et enfin la quatrième langue était le Tetum qui était, parmi les douze langues locales, celle qui était la plus répandue et celle qui avait été adoptée par l’église catholique en 1981.
Cette multiplicité de langues entrainait une multiplicité de références culturelles, administratives et juridiques. De même que les Timorais n’étaient pas d’accord entre eux sur ce que devait devenir le Timor, de même il n’y avait pas au sein d’UNTAET une vision commune des solutions à proposer. Pour les Américains, en vertu du principe que ce qui fonctionne aux Etats-Unis doit pouvoir fonctionner dans le reste du monde, il fallait établir un Etat fédéral. J’étais opposé à cette solution car je pensais que l’une des plaies du Timor était la division. Division entre villages qui passaient leur temps à se chamailler, voire à se faire la guerre, division dont avaient su tirer parti les Portugais pendant la colonisation. Division entre ethnies et entre langues ; Ce qu’il fallait au Timor était un Etat centralisé avec une représentation locale de l’Etat dans les districts.
De même pour la constitution. Les Américains prônaient un régime strictement présidentiel. Ce qui, dans un Etat en gestation où les traditions démocratiques sont faibles, est la porte ouverte aux coups d’Etat. Finalement les Timorais se sont prononcés sur une constitution analogue à celle du Portugal avec un président élu au suffrage universel pour cinq ans mais ayant peu de pouvoirs. Il choisit un premier ministre responsable devant le Parlement, premier ministre qui exerce l’essentiel des pouvoirs. Comme au Portugal, le Timor a une assemblée unique.
Le fait que nous venions de pays aux systèmes juridiques différents, empêchait la mission d’avoir une vision commune sur le système de droit à établir.
Devant le vide juridique créé par le départ des Indonésiens et en l’absence de tout code immédiatement disponible, l’une des premières décisions de l’ATNUTO a été de déclarer que la loi indonésienne restait valable tant que cette loi était conforme aux normes internationales. Ce fut un tollé chez les Timorais. « Vous nous libérez de notre occupant et vous nous maintenez la loi de l’occupant ! Quel scandale ! » Nous n’avions pas le choix : la mission n’arrivait pas avec dans ses bagages un kit juridique, prêt à être utilisé et admis par tous. Le nouveau code pénal et de procédure pénale mit un certain temps à être rédigé. Et en attendant, nous avons mis plusieurs mois à obtenir une traduction en anglais du code indonésien.
Cela a eu pour conséquence la difficulté d’établir un système judiciaire.
Il fallait bien sûr établir un système judiciaire mais une question lancinante se posait : Par qui rendre la justice ? Avec un bel enthousiasme et quelques jours avant que je n’arrive, dans les premiers jours de son existence, UNTAET décida que la justice au Timor devait être rendue par des magistrats timorais. L’idée était belle et semblait tomber sous le sens. Mais le problème était qu’il n’y avait pas de magistrats timorais. Qu’à cela ne tienne.
On sélectionna les quelques rares Timorais qui avaient étudié le droit dans des universités indonésiennes, mais dont aucun n’avait de diplôme ou n’avait vu de près ou de loin un tribunal. On leur donna une formation éclair à Darwin en Australie. On les fit venir au Timor. On leur donna une toge noire. On leur fit prêter serment de se montrer impartiaux dans leurs décisions qui devaient être prises en toute indépendance. Et rien ne se passa. Ayant des difficultés matérielles de locaux, mais ayant surtout une connaissance insuffisante du droit applicable, les magistrats timorais n’avaient rendu aucune décision au bout de six mois. Nous ne pouvions pas, pour des délits, voire des crimes, garder les gens en prison indéfiniment sans jugement. Il fallut faire venir d’urgence des magistrats
internationaux pour aider les magistrats timorais et même les suppléer. Ce cas de figure où la justice nationale est rendue conjointement par des magistrats locaux et internationaux existe d’ailleurs dans d’autres pays : le Sierra Leone, le Cambodge et le Kosovo. Mais dans aucun de ces pays, ce système fonctionne parfaitement.
Un autre problème politico juridique se posait à la mission. Un grand nombre de crimes de guerre avaient été commis par les milices pro indonésiennes dans la période située entre le référendum qui avait eu lieu le 30 août et l’évacuation complète du Timor par les troupes indonésiennes qui s’était terminée le 30 octobre. Il n’entrait pas dans le mandat d’UNTAET de traduire les criminels en justice, cela d’autant moins qu’ils se trouvaient tous en Indonésie. Deux options étaient possibles : soit créer une cour spéciale de justice internationale comme on l’avait fait pour le Ruanda ou pour l’ex Yougoslavie, soit laisser l’Indonésie juger ces crimes. Les personnels de l’ONU et les ONG des droits de l’homme, comme Amnesty International ou Human Rights Watch étaient en faveur de la première option. L’Indonésie, pour des raisons évidentes, préférait la deuxième option, celle où les tribunaux indonésiens jugeraient les criminels de guerre. Les Timorais avaient des vues divergentes. L’évêque de Dili, Mgr Belo pensait qu’avant la réconciliation, il fallait que la justice passe et que cette justice devait être internationale. Pour Xanana Gusmao, il fallait au contraire préserver l’avenir. Que pesait le Timor avec son million d’habitants face à l’Indonésie qui en avait plus de 200 millions ? Par la force des choses, le Timor devait s’entendre avec son puissant voisin. Finalement l’ONU confia à l’Indonésie le soin de juger les criminels de guerre. Des procès eurent effectivement lieu. Mais le résultat a été celui auquel on pouvait s’attendre. Ce fut davantage une opération de blanchiment que l’expression de la justice. Les leaders des milices tout comme les généraux de l’armée indonésienne furent innocentés au grand dam de tous les défenseurs des droits de l’homme.
- Cinquième caractéristique de la mission : une participation croissante mais difficile des Timor
Il n’était pas question que l’ONU devienne le troisième colonisateur du Timor après le Portugal et
l’Indonésie. Il était donc indispensable d’associer les Timorais à la définition de ce qu’ils voulaient que leur pays devienne. Ils devaient se reconnaître dans cette construction qui autrement n’aurait pas été viable.
Les Timorais qui avaient émigré, avaient vécu soit en Australie, soit au Mozambique, soit en Angola. Ils étaient séparés par de profondes divergences politiques, ceux qui s’étaient exilés au Mozambique ou en Angola étant beaucoup plus à gauche, voire marxistes, que ceux qui avaient vécu en Australie. Ils n’avaient en commun que leur passeport portugais, puisque le Portugal avait donné à tous les émigrés, un passeport pour qu’ils ne soient pas apatrides. Ils avaient aussi une foi commune dans l’indépendance du Timor et la volonté de rejeter tout ce qu’en un quart de siècle, l’Indonésie avait pu apporter à ce territoire. Aucun leader timorais revenu d’exil ne parlait la langue indonésienne, sauf Xanana Gusmao qui l’avait apprise dans les prisons de Djakarta où il avait passé 7 ans. Tous, sauf Gusmao, étaient déphasés par rapport à ce qu’était devenu le peuple timorais pendant leurs 25 années d’absence. Certains, qui parlaient parfaitement le portugais, ne parlaient pas le Tetum, la langue véhiculaire de leur pays. Ils avaient besoin d’un interprète dès qu’ils s’adressaient à leurs concitoyens.
La volonté non seulement d’associer les Timorais à la prise de décisions mais aussi de leur transférer rapidement cette prise de décisions, a été constante. Elle s’est manifestée par la création très rapide d’une instance consultative (mais en fait décisionnelle) regroupant les différentes composantes des forces politiques timoraises : le conseil consultatif national devenu en juillet 2000, le conseil national, embryon et préfiguration de l’assemblée nationale élue. Le conseil consultatif national se réunissait une fois par semaine ou plus si nécessaire. Toutes les décisions d’UNTAET lui étaient soumises et en particulier tous les projets de « régulations » c’est-à-dire de décrets.
La manière selon laquelle Sergio Vieira de Mello menait les débats était particulièrement consensuelle puisque il s’efforçait d’obtenir l’accord de tous les représentants timorais au sein de ce conseil. Grâce à des trésors de diplomatie, il parvenait à obtenir cet accord unanime qui était loin d’être acquis car fréquemment les Timorais divergeaient entre eux. Des heures et des heures de discussion étaient souvent nécessaires. Même si Sergio Vieira de Mello avait reçu du conseil de sécurité les pouvoirs d’un despote éclairé, la pratique quotidienne, fondée sur le consensus des représentants timorais, était loin d’être celle de Catherine II ou de Joseph II. Et lorsque Sergio Vieira de Mello était à l’étranger, participant à des réunions à New York ou à Genève, je présidais le conseil consultatif, devenu plus tard le conseil des ministres et je procédais de la même manière.
Cette volonté d’associer les Timorais à tous les stades non seulement de la décision mais aussi de la mise en œuvre de cette décision, s’est prolongée lorsque le premier gouvernement a été formé. C’est en effet une étape très importante dans la « timorisation » qui a été franchie en juillet 2000 quand le pilier gouvernance et administration publique a été dissous et transformé en administration provisoire du Timor Oriental (East Timor Transitional Administration : ETTA). Un gouvernement a été formé qui était présidé par le représentant spécial du secrétaire général de l’ONU mais où les Timorais étaient majoritaires. Sur les 12 portefeuilles, UNTAET détenait 4 portefeuilles : la police et la sécurité civile, la justice, les finances et enfin les affaires politiques constitutionnelles et électorales J’avais le portefeuille de la police et de la sécurité civile en plus de mes fonctions de représentant spécial adjoint. Les autres portefeuilles étaient détenus par les Timorais: affaires intérieures, infrastructure et transports, affaires économiques et affaires sociales (ce dernier portefeuille comprenant aussi l’éducation). Toutefois cette volonté d’associer les Timorais aux décisions et de leur transférer progressivement les commandes, s’est heurtée à trois obstacles.
Le premier obstacle a été l’absence de compétences professionnelles des Timorais. L’Indonésie avait traité le Timor comme une colonie. Les fonctionnaires étaient venus de Java avec l’armée indonésienne. Corneille aurait dit : « Le flux les apporta, le reflux les remporte. » Les fonctionnaires indonésiens étaient repartis en septembre 1999, sans que, en ses 25 ans d’occupation, l’Indonésie ait formé des compétences locales. Dans tous les domaines, avant de recruter des fonctionnaires timorais, il a fallu organiser des formations.
Le niveau de départ étant très bas, les formations étant ralenties ou handicapées par des problèmes de traduction, la mise à niveau des fonctionnaires prenait du temps. Il était irréaliste de s’imaginer que, dans un laps de temps très court, il était possible de donner aux Timorais des compétences professionnelles qui ne peuvent être acquises qu’après plusieurs années d’apprentissage dans le reste du monde. Le Timor oriental était voué à utiliser pendant de longues années les services d’experts étrangers.
Le second obstacle était l’impatience.
Nombre de leaders timorais, impatients de gérer par eux-mêmes leur pays et sous estimant les difficultés, demandaient à UNTAET de faire des miracles. Dans leur impatience, les leaders timorais reflétaient ce que pensait la population. Elle voulait voir son niveau de vie s’améliorer immédiatement. Elle voulait que l’administration timoraise naissante embauche des effectifs nombreux.
Elle trouvait que les salaires étaient insuffisants. Dans cette période où tout se mettait en place mais où peu d’effets tangibles et visibles étaient perceptibles, dans cette période où une urgence chassait l’autre, la gestion du Timor n’était pas un long fleuve tranquille.
Des manifestations avaient lieu devant le bâtiment du gouvernement et il fallait parfois parler aux manifestants pour contenir leur impatience qui se serait autrement transformée en émeute avec l’incendie du bâtiment gouvernemental.
Le troisième obstacle était dans le recrutement de la mission internationale elle-même.
Il faut dissiper deux illusions. La première est que la composition d’une mission de maintien de la paix s’apparente à celle d’une équipe olympique. Dans une équipe olympique, après une sélection sévère, on envoie les meilleurs. Rien de tel pour une mission de maintien de la paix. On a une coupe transversale de l’administration et des compétences techniques des Etats-membres. Il y a de très bons éléments, compétents et actifs. Il y en a de moins bons. Et il y en a aussi de très mauvais. Ce serait d’ailleurs une erreur de croire que les bons sont le monopole des pays développés. Bons et moins bons se trouvent dans tous les Etats-membres.
Ce serait également une erreur de croire que dans des domaines aussi divers et complexes que les compétences civiles d’une mission, l’ONU dispose d’une task force prête à intervenir. Les contraintes, qui s’imposent aux Nations Unies, sont très fortes dans le domaine du recrutement du personnel, notamment en matière d’équilibre entre les Etats-membres et d’équilibre entre hommes et femmes. Tout est centralisé à New York et l’évaluation des capacités professionnelles des candidats y est faite de manière très insuffisante.
Dans UNTAET, qui était une mission de création de structures politiques et administratives, j’étais le seul dont le métier était d’être administrateur. C’est d’ailleurs pour cela que Vieira de Mello avait demandé à l’ONU de solliciter le gouvernement français pour que le numéro deux de la mission, celui qui aurait la tâche d’installer et de faire tourner la machinerie de l’Etat et de l’administration, soit un préfet français, en raison de la variété des compétences exercées par un préfet dans le système administratif français. Mes collaborateurs n’avaient jamais travaillé dans une administration. Ils découvraient sur le terrain et dans des conditions difficiles, la réalité administrative.
Mes collaborateurs sont arrivés moins rapidement que moi. L’ONU ne dispose pas d’un fichier de compétences auquel il est possible de faire appel rapidement pour un déploiement sur le terrain en l’espace de quelques semaines. Dans tous les domaines, les effectifs sont arrivés petit à petit et ont mis 6 mois pour être au complet. Le temps de rodage de la mission a été long. Il a été d’autant plus long qu’au quotidien, la mission vivait dans des conditions difficiles.
Les conditions matérielles de la mission étaient difficiles.
C’est dans des bâtiments pillés et saccagés quand ils n’avaient pas été incendiés que s’est installé UNTAET. Les Nations unies firent venir rapidement des bâtiments préfabriqués, que l’on appelait Kobé houses car elles avaient servi après le tremblement de terre de Kobé. Des générateurs furent installés permettant d’avoir de l’électricité.
Après un mois et demi de campement provisoire où 30 % de la mission attrapa la malaria, un bateau hôtel arriva dans le port de Dili et permit de loger une bonne partie des personnels internationaux, le reste trouvant à se loger en ville dans des maisons qui commençaient à être réparées.
Les conditions dans les districts étaient tout aussi dures. Ni eau potable, ni même eau courante, pas d’électricité, des télécommunications inexistantes, des ravitaillements deux fois par semaine par hélicoptère, les routes étant impraticables. De l’avis de vétérans des missions des Nations Unies qui avaient vécu l’Angola, la Namibie, le Cambodge, le Guatemala, les conditions de vie et de travail au sein d’UNTAET étaient, au début de la mission, les plus difficiles qu’ils aient connues.
Outre ces problèmes matériels UNTAET a rencontré de nombreuses difficultés dans la construction du nouvel Etat.
Il fallait donner au Timor oriental les moyens d’assurer par lui-même sa sécurité puisque l’intervention de la police internationale ne pouvait pas s’éterniser. Un moyen essentiel consista à créer une police locale, formée par la police internationale et à laquelle progressivement toutes les compétences d’ordre et de sécurité publiques seraient transférées. L’un des obstacles était sans doute
la perception que les fonctionnaires de l’ONU avaient de ce que nous devions créer. Traditionnellement une mission de maintien de la paix intervient avec un objectif humanitaire et la volonté de faire respecter les droits de l’homme dans un pays qui est en train de sombrer dans l’anarchie et la tyrannie. C’était bien entendu aussi les objectifs majeurs d’UNTAET. Mais, à la différence des missions de maintien de la paix qui ont précédé et de celles qui ont suivi (mis à part le Kosovo), il s’agissait aussi de créer un Etat. Or une définition de l’Etat donnée par le Professeur Vedel dans son cours à Sciences Po est que l’Etat a le monopole de la contrainte organisée. La police, la justice, l’administration pénitentiaire faisaient partie des institutions que nous devions mettre sur pied. Ensuite l’armée s’y est ajoutée dans des conditions que je vais décrire. Or police, administration pénitentiaire et armée ne faisaient pas du tout partie du patrimoine génétique des fonctionnaires internationaux de l’ONU. Pour nombre d’entre eux ces institutions étaient synonymes d’oppression. Ils avaient du mal à accepter que la défense des libertés et des droits de l’homme passait aussi par la création d’une police compétente, responsable et soucieuse de respecter des pratiques démocratiques et que, dans cette optique, la police ne devait pas être considérée systématiquement comme l’ennemie des libertés publiques mais au contraire comme une institution participant à la défense des droits de l’homme.
Le recrutement et la formation des policiers timorais furent faits de façon intensive car UNTAET souhaitait transférer cette compétence rapidement aux Timorais pour ne pas apparaitre comme la nième incarnation d’un pouvoir colonial. Nous pensions que seule une police locale, parlant la ou les langues locales et ayant la confiance de la population peut être efficace. A partir de rien, nous avons recruté des policiers
timorais, construit une école de police où ils ont été admis en internat et ont reçu une formation de six semaines, formation qui s’est allongée par la suite. Mais il est évident que ce n’est pas en six semaines que l’on forme un policier. Les policiers timorais travaillaient en binôme avec les policiers internationaux, dans l’esprit d’une police de proximité. Ensuite les policiers internationaux se sont progressivement effacés. Cependant quelques années plus tard, en 2006, lorsque la police timoraise a dû faire face à des problèmes importants d’ordre public, elle n’a pas été à la hauteur des défis. C’est donc la police internationale qu’il fallut rappeler.
La sécurité intérieure devait être assurée mais aussi la sécurité extérieure. A l’origine de la mission, il n’était pas envisagé de doter le Timor oriental d’une armée. On imaginait que le Timor oriental pourrait être à l’image du Costa Rica qui, comme chacun sait, est un Etat sans armée. La multiplication d’escarmouches avec la frontière du Timor occidental, les incursions dans le Timor oriental de milices pro-indonésiennes venues de l’autre côté de la frontière, semer la terreur obligeaient la communauté internationale à maintenir une présence militaire étoffée, c’est à dire coûteuse. De plus on n’avait pas réussi à trouver une nouvelle mission à l’armée de libération timoraise qui était parquée oisive et démoralisée, dans des cantonnements sordides dans les montagnes au sud de Dili.
La création d’une petite armée timoraise allait permettre de faire d’une pierre deux coups, c’est à dire d’une part d’éviter de mobiliser en permanence des forces internationales pour garder la frontière et d’autre part de donner une mission aux anciens guérilleros inactifs et sans perspectives d’avenir. Une étude faite par le King’s College de Londres à la demande d’UNTAET a établi des propositions d’une infanterie légère de 1600 hommes. A l’automne 2000, j’ai été chargé de la mise en œuvre de ce programme. Il fallut donc créer de toutes pièces une armée, sélectionner ceux qui en seraient membres, construire des casernes, donner à cette armée un cadre législatif et règlementaire, lui acheter des armes ce qui ne fut pas simple. Acheter des armes ! Imaginez cela : une mission de maintien de la paix qui achète des armes ! C’était une grande première dans l’histoire de l’ONU. C’était, je l’avoue, une tâche tout aussi nouvelle pour moi. J’ai réuni les représentations diplomatiques au Timor mais, pour des raisons multiples, aucun Etat ne voulait donner ou même vendre des armes au Timor. Finalement ce sont les Australiens qui ont accepté de mettre à notre disposition 600 fusils automatiques américains. Mais pour cela, il fallut l’aval du Congrès de Etats- Unis, car lorsque les Australiens avaient acheté ces armes, une clause du contrat – que l’on appelle en termes techniques un caveat – indiquait qu’elles ne pouvaient être cédées à personne, sauf approbation du Congrès.
Au moment de mon départ du Timor, fin juin 2001, l’armée existait. Une moitié des anciens guérilleros avait pu être intégrée, l’autre moitié bénéficiait de programmes de réinsertion dans la vie civile, programmes menés par l’OIM.
La volonté de l’ONU était d’aller le plus rapidement possible à l’indépendance. Tout l’y poussait : l’impatience des Timorais d’être enfin maîtres chez eux, le sentiment de nombreux pays que l’on appelle en anglais « donor fatigue », autrement dit la lassitude des pays bailleurs, qui se disaient qu’on avait déjà donné beaucoup pour un pays de 800 000 habitants (c’était le chiffre de la population de l’époque) et que d’autres urgences mobilisaient la communauté internationale.
Une assemblée constituante a été élue le 30 août 2001. Ses 88 membres avaient comme mission de définir la future constitution, sur des projets qui lui étaient soumis par UNTAET. En février 2002, le document était approuvé. La constitution prévoit un régime parlementaire avec une seule assemblée élue pour 5 ans, un président de la République élu lui aussi pour 5 ans, qui nomme le premier ministre et peut dissoudre
le parlement, promulgue les lois mais a, pour le reste, surtout des fonctions honorifiques et de représentation. Le premier ministre est responsable devant l’assemblée. Cette constitution instaure le portugais et le tetum comme langues officielles. Le président de la République est élu le 14 avril 2002. 82 % des suffrages sont allés à Xanana Gusmao. Après l’élection présidentielle, il n’y avait pas lieu d’élire l’Assemblée, l’assemblée constituante se transformant en assemblée législative et devenant de plein droit le parlement du Timor oriental. Le 20 mai 2002 le Timor devenait
indépendant et le 191e Etat membre de l’ONU sous le nom de République démocratique du Timor Leste, avec son drapeau qui reprenait les couleurs du FRETILIN et était une référence au combat pour l’unité nationale. Le triangle noir représente le sombre passé qu’il faut surmonter, le jaune rappelle les traces du colonialisme et le rouge symbolise la lutte pour la libération nationale. L’étoile est « la lumière qui nous guide », et sa couleur blanche est symbole de paix.
Au moment de l’indépendance, l’ONU pouvait se retourner avec une certaine satisfaction sur le travail accompli. En l’espace de 28 mois, le Timor oriental dévasté, était largement reconstruit. Il avait sa sécurité intérieure et extérieure assurée. Il avait connu la mise sur pied d’une administration centrale et territoriale, d’un système judiciaire, d’une police, d’une organisation pénitentiaire, d’une armée, d’une
constitution, de codes de lois et de régulations, d’un système bancaire coordonné par une banque centrale, d’une éducation nationale, d’une organisation fiscale, d’une organisation du développement agricole. Des accords pétroliers avec l’Australie avaient été négociés, assurant au Timor des ressources amples et pérennes. Tout cela était désormais géré par les Timorais qui étaient devenus maîtres chez eux, pour la première fois dans leur histoire.
Vraiment l’ONU avait des raisons d’être satisfaite de cette réussite qui était saluée par l’ensemble de la communauté internationale. Mais elle pouvait aussi se demander si son retrait n’était pas prématuré et si ce qui avait été amorcé et ce qui avait été réalisé, allait durer. Avions-nous construit un village Potemkine qui allait se démanteler après les cérémonies de l’indépendance ?
Trois questions majeures se posaient alors : Le nouveau gouvernement aurait-il la capacité de prendre le relais ? Le Timor oriental bénéficierait-il d’une stabilité politique ? Ferait-il un bon usage des ressources publiques ?
Sur la capacité de prendre le relais.
La question n’était pas tellement celle des qualités des membres du gouvernement que
celles des ressources humaines de l’administration chargée de mettre en œuvre les décisions du gouvernement. Ce n’est pas en 27 mois que l’on crée ex nihilo une administration à partir d’un pays dont la majorité des habitants sont analphabètes. Le problème des langues était un handicap majeur. Dans ce pays où, après 25 ans d’occupation, une partie importante de la population comprenait la langue
indonésienne, le Timor avait décidé pour des raisons purement politiques, que la langue officielle serait le portugais. Mais, mis à part les acteurs du combat pour la libération nationale et les exilés, il n’y avait pas plus de 5 % de la population qui comprenait encore le portugais. La décision de faire du portugais la langue d’enseignement dans les écoles était inapplicable dans l’immédiat car il n’y avait pas d’enseignants connaissant cette langue. Heureux de pouvoir ancrer la lusophonie dans le sud est asiatique, le Portugal fit un effort immense et envoya plusieurs dizaines d’enseignants portugais aider le Timor à relever ce défi. Cela n’était pas suffisant. Et donc l’enseignement a continué d’être très largement donné en langue indonésienne. Comme on ne pouvait pas, pour des raisons politiques, faire venir des manuels scolaires d’Indonésie, on les fit venir de Malaisie dont la langue est quasiment la même que l’indonésien. Le pari n’est toujours pas gagné puisque, douze ans après l’indépendance, l’alphabétisation n’a pas progressé et le portugais n’est compris que d’une minorité.
On constate également que, pour des raisons diverses, beaucoup d’enfants quittent l’école après un début de scolarisation. La scolarisation n’est pas facile : 41 % de la population a moins de 14 ans. Et 70 % de la population vit en zone rurale ce qui complique la tâche, du fait de la dispersion des populations et de la très mauvaise qualité des routes ou souvent même de leur absence.
Le Timor oriental reste un Etat fragile politiquement.
Xanana Gusmao, héros de la résistance timoraise, adulé par la population, était à l’époque pour le Timor ce que Nelson Mandela était à l’Afrique du sud. Avec l’indépendance, l’ONU avait mis fin à UNTAET et l’avait remplacé par UNMISET (United Nations Mission of Support of East Timor) qui regroupait essentiellement un contingent de militaires (5000 militaires qui restèrent jusqu’en 2004) et 1200 policiers internationaux et 300 conseillers administratifs. L’évolution étant jugée favorable, les effectifs d’UNMISET furent progressivement réduits, avec pour objectif de passer le relais aux Timorais en mai 2005. En mai 2005 la transition se fit d’UNMISET à UNOTIL (United Nations Office for Timor Leste), un simple bureau de liaison politique qui n’avait sous ses ordres aucune force militaire ou policière.
Quelques mois plus tard, en janvier 2006, un groupe de 150 militaires de la nouvelle armée du Timor adressait au président Xanana Gusmao une lettre se plaignant des discriminations dont, à leurs yeux, les membres de la force de défense originaires de l’ouest du pays souffraient de la part des officiers originaires de l’est. La réponse du premier ministre Mari Alkatiri, fut de licencier les militaires qui s’étaient mis en grève. Un tiers de l’armée fut licencié, ce qui n’améliora pas les choses. La querelle fut attisée par une opposition entre le premier ministre Mari Alkatiri aux tendances autoritaires et chef du parti FRETILIN et le président Xanana Gusmao plus ouvert et ayant une approche moins sectaire.
Des troubles éclatèrent au sein de l’armée à Dili, la capitale. Une guerre civile commença. Une quarantaine de personnes furent tuées et des centaines d’habitations furent brûlées. Prenant peur, 100 000 personnes se réfugièrent dans les montagnes.
Et pendant des mois, plus de 100 000 personnes subirent la mousson dans des camps de réfugiés sous la protection précaire de toiles de bâche du Haut commissariat aux réfugiés. On était presque revenu à la case départ.
Le Timor était ressaisi par ses vieux démons de désunion et de guerres ethniques et fratricides. Et là il n’y avait pas de colonisateur ou d’occupant sur qui rejeter le blâme. L’ONU envoya 5000 soldats australiens, néo zélandais et malaisiens pour restaurer un ordre et une sécurité que les Timorais étaient incapables d’assurer. Visiblement l’ONU avait quitté le Timor trop tôt. Les hommes politiques timorais durent en convenir et, à la demande du Timor, une nouvelle mission de l’ONU fut installée par la Résolution du Conseil de Sécurité 1704 du 25 août 2006. L’UNMIT (United Nations Integrated Mission in Timor Leste-MINUT en français) avait une composante de police internationale forte de 1600 policiers et une trentaine d’observateurs militaires.
Le 11 Février 2008, nouvelle alerte. Un groupe de soldats félons tenta d’assassiner le président, José Ramos-Horta, et le premier ministre, Xanana Gusmão. Durant ces attaques Ramos Horta a été très grièvement blessé et le meneur de cette attaque a été tué. La vie du Président Ramos Horta a été sauvée grâce à une intervention médicale et un transport rapide en Australie.
La situation politique s’est depuis stabilisée. La nouvelle élection présidentielle du Timor s’est déroulée en 2012 sans incident .A été élu président Taur Matan Ruak- qui veut dire en langue tetum deux yeux perçants, ce qui est le nom de guerre de José Maria de Vasconcelos. Il a passé de longues années dans la jungle avec Xanana Gusmao, dont il était l’adjoint, et lui a succédé comme chef de l’armée de libération. Il est aussi l’ancien ministre de la défense du Timor indépendant. A la dernière élection
présidentielle, il a battu le président sortant, le Prix Nobel José Ramos Horta. Xanana Gusmao est resté premier ministre.
Le mandat de la MINUT a pris fin le 31 décembre 2012. La situation politique reste cependant fragile car on ne voit pas se profiler de renouvellement du personnel politique. Ce sont les mêmes hommes que j’ai connus en 1999, ceux qui, depuis 1975, ont mené le combat pour l’indépendance, qui détiennent toujours le pouvoir. Pour l’instant, ils n’ont pas transmis les leviers de commande à une autre génération. Le premier ministre Xanana Gusmao a 68 ans. A plusieurs reprises ces dernières années, il avait annoncé son intention de se retirer. Il a remis sa lettre de démission, le 6 février au président de la République. Quel que soit son successeur il n’aura pas la stature historique de Gusmao. Les dissensions risquent de reprendre. Donc il y a là une instabilité et une fragilité du Timor dans ce pays où les deux tiers de la population ont moins de trente ans.
Enfin la troisième question qui se posait au moment de l’indépendance et qui se pose toujours est le risque de faire un mauvais usage des ressources publiques. Le Timor oriental reste un pays fragile économiquement et très dépendant des ressources gazières et pétrolières. Ce pays très pauvre bénéficie, pour un temps limité, de la manne des gisements pétroliers, exploités sur le plateau continental à mi chemin entre l’Australie et le Timor, qu’on appelle Timor Gap.
90 pour cent des revenus du Timor sont issus du pétrole et du gaz et sont de l’ordre de 2 milliards de dollars par an. A quoi sert cet argent ?
L’idée de départ était de ne pas utiliser ces royalties dans l’immédiat et de constituer un fonds de réserve devant servir à l’investissement pour les générations futures. Ce fonds qui s’appelle the East Timor Petroleum Fund, compte 16 milliards de dollars en novembre 2014. Cependant la tendance du gouvernement est de piocher dans ce fonds pour financer des dépenses sociales pour améliorer la vie quotidienne des Timorais, ce qui se comprend vu l’extrême pauvreté des Timorais.
Selon la Banque asiatique de développement, le gouvernement finance trois programmes de transferts de fonds : l’un pour les vétérans, un autre pour les personnes handicapées et les aînés et le troisième pour les mères monoparentales qui envoient leurs enfants à l’école. Ces programmes bénéficient, dans l’ensemble, à plus de 100 000 personnes. Les écarts entre les sommes versées aux trois groupes sont cependant énormes : « Les transferts d’espèces avec conditions assorties sont limités à 240 dollars par année, les pensions pour les personnes âgées s’élèvent à 360 dollars par année et les vétérans touchent entre 2 760 et 9 000 dollars par année. »
« Les pensions versées aux vétérans en 2011 comptaient pour la moitié du budget total des transferts alors qu’elles ne concernaient qu’un pour cent de la population du Timor-Leste », indique la Banque mondiale qui ajoute « Les bénéficiaires de ces allocations importantes ne sont pas suffisamment nombreux pour qu’il y ait un impact notable sur le taux de pauvreté dans le pays. » Mais c’est également un moyen pour le gouvernement d’acheter une paix sociale, les anciens guérilleros pouvant être remuants s’ils ont des motifs d’insatisfaction.
L’agriculture représente moins du quart du PIB non-pétrolier en 2012 mais fournit les trois quarts des emplois. Elle est aussi le seul moyen de subsistance pour un tiers des ménages. Elle a une productivité très inférieure au reste de l’Asie du sud-est. Les cultures sont principalement vivrières (riz, maïs, manioc). L’autosuffisance alimentaire ne soit pas atteinte. La population du Timor Oriental est l’une des plus
pauvres de l’Asie et cette pauvreté s’est accrue passant de 40 % de la population en 2001 à 50 % en 2007. Après le Burundi et l’Erythrée, le Timor est le pays où la population est la plus sous alimentée, la situation s’étant dégradée fortement entre 2005 et 2014 selon le Global Hunger Index publié par l’International Food Policy Institute.
L’explosion démographique aggrave les problèmes économiques. Le taux de fécondité est l’un des plus élevés de la planète avec une moyenne de 6,4 enfants par femme en 2009, un taux de natalité de 35 pour mille, c’est à dire le triple de la France. Même si ce taux est en baisse, de même que le taux de mortalité infantile, la
population du Timor qui était de 800 000 habitants en 1999 est passée à 1,2 million en 2014.
J’ajoute que l’investissement étranger privé ne se développe pas pour deux raisons essentielles : d’une part le Timor ne dispose toujours pas d’une loi fixant le régime de la propriété et le système de gestion des terres. L’absence de cadastre rend totalement opaque le droit de la propriété qui relève de trois régimes juridiques qui se superposent et se contredisent. Il existe au départ un droit coutumier lié à la tradition animiste qui organise une utilisation collective des terres. S’y superpose le droit portugais qui régit les domaines qui se sont constitués durant la colonisation. S’y ajoute le droit indonésien qui s’est appliqué quand les propriétés portugaises ont été confisquées par l’occupant indonésien et données par l’Etat à des militaires ou des fonctionnaires qui les ont ensuite revendues. Et enfin, pour compliquer le tout, il existe des dizaines de milliers d’occupants sans titre qui se sont installés là où ils le pouvaient, après avoir perdu leurs biens incendiés ou détruits en 1999 ou en 2006 et squattent des propriétés. De nombreuses propriétés sont toujours occupées illégalement.
UNTAET avait reculé, ne pouvant régler une question aussi complexe dans le laps de temps imparti à la mission. Quinze ans plus tard, le Timor indépendant n’a pas beaucoup progressé. Les conflits de propriété se sont multipliés et il n’existe pas de mécanisme arbitral ou juridictionnel efficace et clair pour les régler.
Le deuxième frein à la venue d’investisseurs est le manque de confiance dans la stabilité politique de cet Etat dans la durée.
Les exportations traditionnelles du Timor de café labellisé, de santal n’ont que peu d’impact économique. Les routes sont dans un état lamentable. Et dans la capitale, Dili, l’électricité n’est pas distribuée 24 heures par jour. De nombreux observateurs se demandent pourquoi le gouvernement n’investit pas davantage dans les infrastructures, utilisant une partie des royalties du pétrole.
Les mêmes observateurs constatent beaucoup de corruption, beaucoup de népotisme et beaucoup de favoritisme, ce qui est classique dans les pays en voie de développement – et pas seulement chez eux d’ailleurs. Transparency International classe le Timor oriental au 133e rang en matière de corruption sur 175 pays recensés.
Ils constatent aussi que l’expulsion des juges internationaux en novembre 2014 rend le système judiciaire timorais beaucoup plus vulnérable aux pressions politiques. Depuis cette expulsion, la question de l’indépendance de la justice au Timor se pose. Et si le pilier de l’indépendance des juges est vermoulu, c’est tout l’équilibre démocratique de l’Etat qui est bancal et de ce fait la confiance de la communauté internationale est atteinte. La possibilité pour le Timor de rejoindre l’ASEAN, l’association des nations d’Asie du sud-est se trouve réduite. De nombreux Etats membres de l’ASEAN et notamment Singapour, ne manifestent aucun enthousiasme à la perspective de la venue du Timor oriental.
*
* *
Il me faut conclure. Beaucoup de fées se sont penchées sur le berceau du jeune Etat du Timor oriental. Ces fées ont apporté beaucoup de cadeaux. Jamais autant d’argent a été dépensé par la communauté internationale pour une population si peu nombreuse. Tous les pays ont apporté leur appui avec un consensus rare dans l’enceinte des Nations unies, se disant que le Timor oriental était un pays martyr et que sa population avait souffert sous la Deuxième Guerre Mondiale et sous l’occupation indonésienne. Il est d’ailleurs révélateur que les pays les plus allants ont été ceux qui, dans le passé, avaient eu quelque chose à se reprocher vis à vis du Timor : le Japon pour l’avoir envahi et maltraité entre 1942 et 1945, l’Australie pour l’avoir utilisé pendant la Deuxième Guerre Mondiale et l’avoir laissé tomber au milieu du conflit, puis pour avoir trente ans plus tard, reconnu une annexion par l’Indonésie qui n’avait aucune valeur sur le plan du droit, enfin le Portugal pour avoir raté sa décolonisation.
L’Australie toute proche a un intérêt particulier pour le Timor, non seulement en raison de la proximité, non seulement en raison de son action pour les pays en voie de développement de la zone Pacifique sud où elle fait figure de super puissance, mais aussi parce que les gisements gaziers de la Mer du Timor, qui sont situés sur le
plateau continental australien, sont partagés entre le Timor et l’Australie. Les redevances de l’exploitation gazière apportent de très loin l’essentiel des ressources du Timor oriental. Mais le Timor voudrait beaucoup plus. Il fait valoir que l’essentiel de ces gisements sont à l’intérieur de la zone économique exclusive de 200 miles qui relève du Timor alors que l’Australie déclare qu’elle se base sur un traité de 1972 qui définissait ses frontières avec l’Indonésie. L’affaire est maintenant soumise à un arbitrage qui devait être rendu au printemps prochain.
Quant au Portugal, il est loin. Ses ressources sont limitées Il concentre son aide internationale sur les anciennes colonies portugaises, l’Angola, le Mozambique, la Guinée Bissau et le Cap Vert. Et son intérêt pour le Timor est surtout dans le domaine culturel : la promotion de la lusophonie, puisque le portugais est la langue officielle du Timor, même s’il reste beaucoup à faire pour que cette langue soit effectivement parlée par la population.
Ces pays qui historiquement avaient des liens avec le Timor, ne sont pas les seuls à s’y intéresser. La Chine avait participé à UNTAET en envoyant des policiers intégrés dans la police internationale. La Chine a signé en avril 2014 un accord avec le Timor pour promouvoir une politique de coopération dans le domaine de l’agriculture, des infrastructures et de l’inter-connectivité. Le Timor fait incontestablement partie de la zone géographique à laquelle la Chine porte un intérêt particulier.
Comme je l’ai dit, les fées se sont penchées sur le berceau du Timor. Elles avaient apporté beaucoup de cadeaux mais elles avaient oublié leur baguette magique. L’opération de maintien de la paix a été une réussite mais elle n’a pas changé les Timorais qui sont restés tels qu’en eux-mêmes, fidèles à leurs divisions, leurs ethnies, leurs querelles et leur violence. Les résultats dans le domaine de l’éducation et de la formation sont lents à obtenir et ne sont toujours pas au rendez-vous. La disette reste présente dans de nombreux districts.
Le Timor est né de ses cendres. Il n’est pas pour autant devenu un phénix. Les espoirs mis par la communauté internationale qui voulait que le Timor devienne très rapidement un modèle de développement et de démocratie étaient sans doute excessifs. Chacun sait que l’apprentissage de la démocratie prend du temps. Chacun sait aussi que les ressources pétrolières n’entrainent pas nécessairement des retombées positives sur l’ensemble de l’économie du pays et sur le niveau de vie de la population. Dans la feuille de route du Timor oriental, les pesanteurs socioculturelles ont sans doute été insuffisamment évaluées.
Le premier ministre Xanana Gusmao a présenté sa démission le 9 février dernier au président de la République Taur Matan Ruak qui l’a acceptée et a nommé le 10 février un nouveau premier ministre. Il s’agit de Rui ARAUJO, âgé de 50 ans, médecin formé en Nouvelle Zélande, qui, à l’Assemblée du Timor, était le leader de l’opposition, et membre du FRETILIN. Il avait été vice- premier ministre et ministre de la santé dans un précédent gouvernement. C’est donc un changement de génération puisque Xanana Gusmao a 68 ans.
Une nouvelle génération de Timorais va accéder au pouvoir. Elle succédera aux leaders historiques qui ont fait beaucoup pour le Timor, mais sont usés par les combats et dont la plupart ont du mal à passer le relais. Cette génération saura peut-être donner au Timor une nouvelle impulsion pour que les résultats soient enfin à la hauteur de nos espérances. Alors l’histoire de ce petit pays exotique que l’on a du mal à situer sur la carte, aura valeur d’exemple. C’est en tous cas le vœu que je forme.
*
* *
Annexes
L’ONU pourrait-elle lancer de nouveau une opération de maintien de la paix comme au Timor oriental ?
Les conditions dans lesquelles le Conseil de Sécurité a décidé de l’OMP au Timor ont été très particulières et ne sont pas facilement reproductibles.
Il y avait un consensus au sein du Conseil de Sécurité sur une intervention. Ce consensus était basé sans doute sur le fait que le Timor n’était pas un enjeu important pour aucune des grandes puissances. Le fait aussi que l’Indonésie ait décidé de son propre mouvement d’un référendum qui, en cas de réponse négative, débouchait nécessairement sur l’indépendance, faisait que l’Indonésie ne pouvait pas s’opposer à l’envoi d’une mission de maintien de la paix sur un territoire qu’elle occupait.
Le résultat de ce consensus est que la mission avait un mandat clair : amener le pays à l’indépendance. Le mandat était loin d’être aussi clair pour le Kosovo, qui est la seule mission de gouvernance comparable au Timor. La plupart des missions de l’ONU qui ont précédé ou qui ont suivi le Timor sont plutôt le résultat de compromis, ce qui sur le terrain, entraine toujours des difficultés. Or en l’absence d’un gouvernement établi sur le territoire du Timor puisque les Indonésiens étaient partis, la mission de l’ONU avait les coudées franches, ce qui n’est pas le cas dans une mission traditionnelle. J’ajoute que le mandat était robuste. On a voulu éviter les erreurs de la Bosnie ou du Ruanda où les missions ont été impuissantes devant des tragédies, faute d’avoir le mandat pour intervenir.
Dernier élément qui fait que, dans mon esprit, le renouvellement d’une mission de ce type est peu probable : c’est une mission coûteuse en effectifs. Le budget des opérations de maintien de la paix qui permettait l’envoi et le maintien de la mission, ne permettait pas de financer les réalisations indispensables pour lancer le nouvel Etat. Il fallut donc faire appel à des fonds dédiés, des trust funds comme on les appelle en anglais, financées par des donations de pays bailleurs.
J’ajoute qu’actuellement 16 opérations de maintien de la paix sont en cours.
Elles mobilisent 112 000 personnes dont 103 000 en uniforme c’est à dire 90 000 soldats et 13 000 policiers internationaux. Elles représentent un budget de 7 milliards de $. Enfin il faut noter que 2,3 milliards de dollars de contributions des Etats-membres n’ont pas été acquittées.
*
* *
Aide au développement au Timor oriental
Selon les chiffres publiés par le ministère des finances du Timor oriental, pendant la période de 2005 à 2014, le Timor oriental a reçu environ 1,5 milliard de dollars d’aide.
Les principaux donateurs sont :
- l’Australie avec 500 M$
- le Japon 400 M$
- les USA 160 M$
- l’Union européenne 145M$
- l’Allemagne 60 M$
- la Chine 66 M$
- le Portugal 52 M$
Ce document indique que la France a donné 58 000 $ pendant cette période.
*
* *
Les ressources pétrolières du Timor oriental.
Dans les années 1970, d’importants champs de pétrole et de gaz ont été découverts dans la Mer de Timor, entre l’Australie et le Timor, sur le plateau continental australien, à mi chemin entre la côte australienne et la côte du Timor.
Il fallait donc répartir l’utilisation de ces ressources en fonction des eaux territoriales. Cette répartition devait être faite à l’origine entre trois pays : l’Indonésie, le Portugal et l’Australie. Après l’invasion du Timor oriental par l’Indonésie, seuls deux acteurs sont restés en lice.
Un traité de 1989 entre l’Indonésie et l’Australie qui avait reconnu l’annexion du Timor a déterminé cette répartition, traité connu sous le nom de Timor Gap. A peine signé, ce traité a été contesté par le Portugal qui était toujours reconnu par les Nations unies comme le seul administrateur légal du Timor, l’annexion indonésienne n’ayant pas été reconnue. La Cour de Justice internationale saisie par le Portugal, s’est déclarée incompétente.
L’indépendance du Timor a modifié la donne qui est actuellement la suivante.
Un nouveau traité connu sous le nom de traité de la mer du Timor a été signé le 20 mai 2002, par l’Australie et la République démocratique du Timor, le jour de son indépendance.
Le champ pétrolier de Bayu Undan dont les revenus étaient partagés entre l’Indonésie et l’Australie à raison de 90 % pour l’Australie et 10 % pour l’Indonésie a vu sa répartition modifiée quand le Timor a pris la succession de l’Indonésie. Dans un geste généreux avant l’indépendance, l’Australie a décidé que 90 % des revenus de ce champ iraient au Timor et que l’Australie garderait 10 %. En réalité, comme le gazoduc va à Darwin en Australie, et que l’Australie bénéficie de la valeur ajoutée des usines de liquéfaction de gaz et de production d’hélium, la répartition des revenus est de l’ordre de 50/50.
Pour les autres champs pétroliers et notamment le champ de Greater Sunrise qui contiennent l’essentiel des ressources, un traité a été signé en janvier 2006 entre le Timor et l’Australie, traité qui porte le nom compliqué de Traité sur certains arrangements maritimes dans la Mer de Timor. Dans ce traité de 2006 l’Australie et le Timor décident de geler leurs revendications sur le plateau continental pendant 50 ans et de se partager moitié les redevances sur le gisement de Greater Sunrise. Les royalties des autres champs pétroliers et gaziers vont toutes à 100 % vers l’Australie. L’Australie déclare que ce gisement se trouve à l’intérieur de ses frontières maritimes telles qu’elle les avait définies avec l’Indonésie en 1972. Le Timor conteste cette interprétation au nom du droit international qui fixe la zone économique exclusive d’un pays à 200 miles nautiques depuis la côte. Si cette règle était appliquée, le Timor oriental disposerait de la quasi totalité du gisement et non pas des 20 % qui lui sont actuellement alloués.
Le Timor a saisi la Cour de Justice Internationale en décembre 2013 pour l’annulation du traité de 2006 répartissant les royalties des champs gaziers entre le Timor et l’Australie. L’un des arguments du Timor oriental était que l’Australie avait mis sur écoutes le gouvernement timorais en 2004 et avait, de ce fait, un avantage indu dans la négociation.
Les choses se sont encore compliquées quand en juin 2014, l’Australie a décidé de réduire de 15 millions $ australiens son aide au Timor. Le Timor n’était pas le seul pays concerné par cette réduction qui concernait tout le programme d’aide au développement de l’Australie.
Finalement en septembre dernier, les relations se sont réchauffées entre Dili et Canberra et les deux parties ont convenu de soumettre la question des redevances à un arbitrage international, le Timor oriental suspendant sa plainte auprès de la Cour internationale de Justice. L’arbitre doit rendre sa décision au printemps 2015.
L’utilisation de ces ressources.
L’idée de départ était de n’utiliser que le revenu du capital qui s’accumulait dans un fonds de réserve
qui devait grossir au fil des années, le fonds de réserve devant servir à l’investissement pour les générations futures. Ce fonds qui s’appelle the East Timor Petroleum Fund compte 16 milliards de dollars en novembre 2014. Le budget du Timor oriental est de 1,5 milliard de dollars et est alimenté pour l’essentiel par les revenus pétroliers. Ces intentions vertueuses ne sont plus respectées. La tendance du gouvernement est de piocher non seulement dans les revenus de ce fonds mais aussi dans le capital pour financer des dépenses sociales pour améliorer la vie quotidienne des Timorais.
